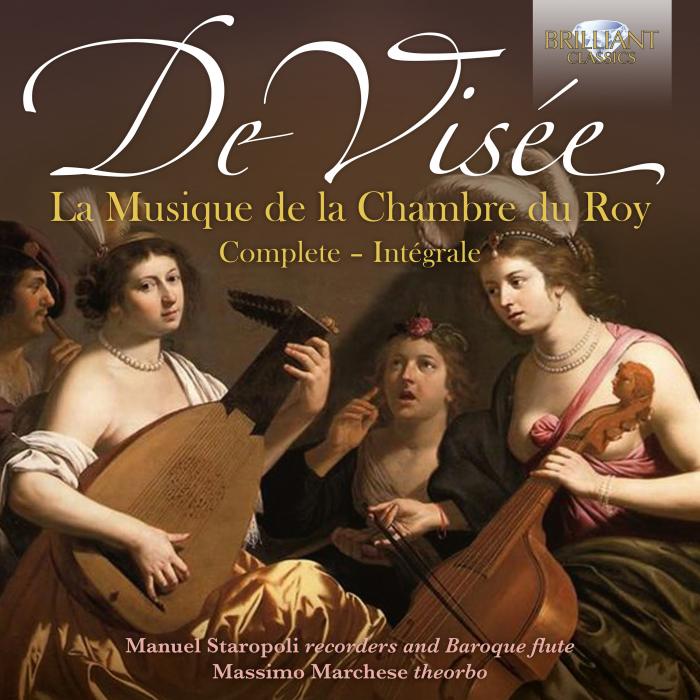par Maëlle Levacher · publié vendredi 10 novembre 2017

Le personnage central de ce livre appelle — ou est visité par — une fée, vieille, qui s’efforce de pratiquer encore la magie dans la mesure du possible, et par un ange qui ne trouve plus qu’en ville de rares occasions d’apparaître aux gens. Le titre de l’ouvrage, La Magie dans les villes, associe donc implicitement ces deux interlocuteurs du personnage, qui sont ses intermédiaires avec le monde autre qu’il accueille en son monde habituel.
La fantaisie et l’étrangeté l’ont généralement emporté sur les autres aspects de cet ouvrage, déjà maintes fois chroniqué, dans l’appréciation des lecteurs enclins à l’émerveillement. On pourrait rééquilibrer la critique consacrée à ce texte en attirant l’attention sur sa tonalité finale pessimiste : pour le personnage, la possibilité de la fantaisie n’a cessé de se réduire, le sentiment de la perte irréversible domine chez celui qui « ne sait plus retenir ce qui s’en va » (derniers mots du livre). Cet homme n’a devant lui aucune issue1 ; pour cette raison sans doute, cette collection de paraboles (le personnage « arrose les chagrins desséchés », p. 41-42 ; il est le protagoniste d’une sorte de conte de Noël p. 65-66), de situations isolées, de dialogues, de tableaux à peine raccordés, ne pouvait se fondre dans la trame d’une intrigue romanesque et devait demeurer une constellation.
Ce livre illustre un état plutôt qu’un cheminement. L’existence du personnage semble atemporelle mais, à y regarder de près, le temps y passe bel et bien : ses enfants grandissent ; on n’arrête pas le temps, on n’empêche par l’inéluctable. Quelque charmant et divertissant qu’il soit, ce texte présente un personnage obsédé et paralysé par l’angoisse de la finitude des choses, des situations, des êtres (p. 64-65). Plein d’heureuses expressions, de formules justes (le « petit air […] de répit mal ajusté » des dimanches, p. 62), ce livre n’est pas léger.
L’imaginaire auquel le personnage a recours, qu’il active, qu’il fond avec la réalité pour lui rendre peut-être de la saveur, peut bien être une forme de résistance à la trivialité du réel et à sa fragilité. Mais il n’est pas un déni : on doit rester lucide, et donc pessimiste. Il n’y a pas de merveille accomplie, toutes les merveilles sont sabotées, inefficientes. Par cela même elles sont attachantes ; elles sont un but en soi, un parti pris. Il fallait qu’elles soient tristes, car la tristesse est une poudre qui avive les choses et les gens, qui les anime (p. 45) ; peut-être est-elle une condition de leur beauté. Le merveilleux surgit dans le réel sans que quiconque s’en étonne, y déploie sa beauté en fée et s’y fait écrabouiller en mouche, mais il n’y a là rien de grave, et le monde avec ses fées-mouches demeure ambivalent pour le personnage comme pour ses interlocuteurs (p. 68). Ce personnage adopte, pour ainsi dire, un cynisme innocent. Lorsqu’il dit à ses enfants : « J’ai froid quand vous avez froid, j’ai faim quand vous avez faim – autant dire que d’un point de vue strictement personnel, je ne sais plus rien ni du froid ni de la faim. » (p. 19), il dit avec cynisme que la parentalité l’a séparé de lui-même, et avec candeur combien il aime ses petits.
Si les dialogues sont drôles, c’est parce que des enfants et leur père répondent avec sérieux à l’incongru de leurs discours respectifs (p. 32, p. 70-71) ; le texte tend alors vers la parodie dans la mesure où il révèle les mécanismes attendus des dialogues ordinaires, mais il a aussi valeur de proposition : pourquoi ne pas accueillir l’incongru, avec simplicité ? Qu’est-ce qu’on risque ? La fée cacochyme et l’ange intermittent sont en fin de vie et de carrière, comme le personnage est en fin de prise avec le réel dérisoire et ses plates contraintes. Il s’abandonne à une dérive intérieure qui lui ouvre un nouvel accès au réel (famille, scolarité des enfants…) transposé dans un ordre autre, où tous peuvent dialoguer d’aplomb avec l’absurde, fabriquer et générer l’impossible sans que cela soit de l’ordre du miracle, de la transcendance. Le personnage se rencontre. Il fait remonter ses souvenirs, pense à ses morts et joue avec eux des scènes dialoguées. Il rencontre son double, aussi ; est-ce à dire qu’il est mort lui-même ? Ne faut-il pas mourir au moi socialement adapté (voir la satire du jeu social, p. 29) pour se rencontrer ? Cet homme qui vit en fantaisie n’est pas un homme qui fuit (la réalité, les responsabilités) mais un homme qui change. Je fais ici une lecture psychologisante du livre, car il me paraît être, pris dans son ensemble, l’allégorie d’un exhaussement de l’intime, qui passe par l’expression et le partage en famille des angoisses qui étaient restée sourdes et veulent désormais se faire entendre. C’est là une expérience que chacun de nous peut vivre. Ce livre, dépourvu de toute dimension prescriptive à l’intention du lecteur, est peut-être pourtant de ceux qui servent de viatique poétique à qui entreprend une rencontre avec soi-même.
Le dernier mot : au Sphinx (p. 32-33), à la bête rabougrie et souffreteuse qui, à bout de forces, n’entend pas la réponse aux questions à laquelle elle a si douloureusement aspiré tout au long de son existence. Cette parabole cruelle nous suspend à une nouvelle énigme : quel est ce sage Œdipe venu trop tard souffler la réponse ?
1. Cependant, une note au bas de cette page de Poezibao annonce que l’ouvrage aura une suite. ↑
INFORMATIONS
Quidam, 2016.
D’AUTRES ARTICLES