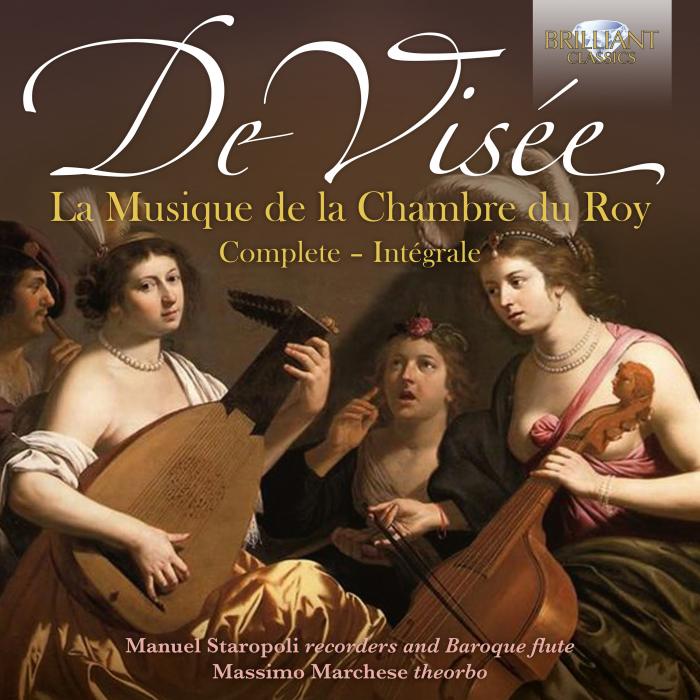par Loïc Chahine · publié jeudi 20 aout 2015

Au moment où, vers le milieu du xviie siècle, commence ce qu’il est convenu d’appeler le « Grand Siècle » français qui verra éclore La Fontaine, Molière, Mesdames de Sévigné et de Lafayette, Racine, La Bruyère, et tant d’autres, le Siècle d’or espagnol touche à sa fin : si Pedro Calderón de la Barca ne meurt qu’en 1681, les poètes Luis de Góngora (1561–1627) et Francisco de Quevedo (1580–1645) ne passent pas la médiane du siècle, non plus que les dramaturges Félix Lope de Vega (1562–1635) et Tirso de Molina (1583–1648). En musique pourtant, les grands noms espagnols sont à placer au siècle précédent (Morales, Guerrero, Cabezón, Juan del Encina, Luis de Narváez ou Alonso Mudarra sont tous des compositeurs du xviie s.) ou dans la deuxième moitié du siècle (encore sont-ils alors moins nombreux, mais on ne saurait passer sous silence Gaspar Sanz ou Francisco Guerau) ou au siècle suivant, avec la prise d’importance des genres opératiques (on pense à Literes et Nebra, entre autres). Serait-ce que les poètes et dramaturges sus-cité n’avaient pas de grands musiciens qui fussent leurs contemporains ? Le programme proposé par La Galanía et intitulé Trésors du baroque espagnol répond à cette question.
Et d’abord, il rappelle que la langue espagnole, le castillan, rayonne quelque peu chez ses voisins au xviie siècle — « d’abord », car le concert s’ouvre par Yo soy la locura, air composé par un français, Henry du Bailly, et publié en France par Gabriel Bataille en 1614. Un tel commencement nous invite à nous rappeler que la plupart des livres d’airs de cour contiennent des pièces en langues étrangères, c’est-à-dire soit en italien, soit en espagnol. C’est le cas par exemple chez Boësset. En fait, il n’y a pas que la langue qui rayonne : la littérature espagnole est relativement bien connue en France, où son influence se fait sentir chez Pierre Corneille, bien sûr (il suffit de penser au Cid), mais aussi chez Molière, qui devait connaître le théâtre du Siècle d’or, ou chez les romanciers comme Scarron, dont le Roman comique contient des nouvelles qui sont globalement imitées de modèles espagnols. Souvenons-nous encore — et La Galanía le rappellera d’ailleurs en bis — que dans le « Ballet des Nations » qui termine Le Bourgeois Gentilhomme, il y a une entrée espagnole avec plusieurs airs en langue originale. Comme l’italien, le castillan est pratiqué par l’aristocratie française.
Qui a pris le soin de regarder les sources des pièces du programme — et il n’y a pas grand mal à se donner car elles sont précisées ! ô joie du maniaco-chercheur ! — remarquera immanquablement que la plupart de celles qui sont des publications et non des manuscrits n’ont pas été publiées en Espagne, mais en France, on l’a dit (ajoutons aux œuvres de Français celle d’un Espagnol, l’ouvrage de Luis de Briceño, Metodo mui facilissimo, Paris, 1626), en Italie (Scherzi amorosi publiés par Steffan à Venise en 1622) et même en Angleterre (Prime Musiche Nuove, Londres, William Hole, 1613).
La plupart des œuvres, en fait, sont anonymes — ce qui explique d’ailleurs qu’elles ne soient pas bien connues. Il y a aussi plusieurs pièces « reconstituées », c’est-à-dire, en fait, recréées par le musicologue Álvaro Torrente à partir des textes et de la grille d’accords. C’est le cas de la Seguidilla de la Venta, dans laquelle un homme, dans un bouge, tente de séduire une femme qui lui fait savoir que s’il veut parvenir à ses fins, va falloir payer, ou de la Jácara de la Trena, chanson sur un poème de Francisco de Quevedo, la Carta de Escarramán a la Mendez, où un truand en prison écrit à son acolyte (féminine) et lui raconte quelques-uns de se hauts faits, sa capture par les forces de l’ordre, et la suite de ses aventures dans la prison, sur un mode grotesque. Il faudrait encore évoquer la Zarabanda del catálogo, où un homme clame son goût pour toutes sortes de femmes, jeunes, vieilles, novices, veuves…
Ces pièces enjouées s’entremêlent avec d’autres plus graves, où l’amant ou l’amante chante ses larmes. On est d’ailleurs surpris de remarquer que ces pièces sont d’allure mélodique plutôt détendues, en général, l’expression de la tristesse relevant plutôt du dépouillement. Il est manifeste, à l’écoute, que la plupart de ces pièces sont, quoique les auteurs des textes puissent être de grands littératures, nettement ancrées dans la musique populaire. Notable exception : le superbe lamento de Pico y Canente de Juan Hidalgo, « Crédito es de mi decoro ». Juan Hidalgo peut être considéré comme le père de l’opéra espagnol. Il est allé en Italie et cela se sent dans son écriture, à mi-chemin entre récitatif et inspiration mélodique, écriture teintée de chromatisme et de virages harmoniques que l’on ne trouve pas dans les autres pièces. Ce n’est sans doute pas un hasard si ce lamento se trouve exactement au milieu du programme.
Immédiatement après la première pièce, Raquel Andueza a eu soin de s’adresser au public, dans un français tout à fait estimable, pour présenter brièvement ce qu’elle venait de chanter et ce qui allait suivre ; elle a ensuite introduit chacune des pièces — attention bienvenue, car nous n’avions pas sous les yeux les textes, si importants. Mais au-delà de l’aspect utile, cela crée aussi une atmosphère, plutôt détendue, et permet à l’esprit de sauter plus aisément d’une œuvre à l’autre, d’une ambiance à une autre — quoique les changements d’atmosphères aient toujours été soigneusement étudié pour ne jamais devenir burlesque.
Raquel Andueza a une voix particulière, arborant souvent un timbre peu lyrique — en particulier dans le médium et le grave — mais plein de charme et par ailleurs très sonore. Une telle manière de chanter m’a paru tout à fait correspondre à l’esprit de la musique choisie. On notera aussi l’articulation, la plupart du temps impeccable, qui permet sans nul doute à ceux qui entendent l’espagnol de comprendre les textes. Par ailleurs, Raquel Andueza chante avec délicatesse et évite tout effet superflu.
Du côté de l’ensemble instrumental, le théorbe de Jesús Fernandez Baena et la guitare de Pierre Pitzl se complètent idéalement, accompagnent sans jamais envahir, avec la complicité de la harpe de Manuel Vilas, qui manquait peut-être d’un rien de liberté çà et là. Le son du violon d’Allessandro Tampieri est brillant, ses traits le sont aussi, peut-être même trop. On se demande par endroits s’il ne s’éloigne pas un peu trop du style des pièces pour redoubler de virtuosité. Les percussions, enfin, confiées à David Mayorali, sont savamment dosées — évidemment, il n’y en avait pas, par exemple, dans le lamento de Juan Hidalgo —, agréablement variées, sans histrionisme. Néanmoins, je m’interroge sur le caractère systématique de leur emploi dans les pièces joyeuses. Dans la mesure où le programme est savamment fabriqué et basé sur une recherche musicologique fine, il est probable que l’usage des percussions a lui aussi été pensé et qu’il ne relève pas du cliché. Quoi qu’il en soit, on l’a dit, elles sont excellemment jouées.
Malgré ces petites réserves, qui tiennent, qu’on le comprenne bien, du doute et non de la réprobation, en voguant d’affetto en affetto dans ces terres ibériques, on passe un moment plus qu’agréable où la rareté du répertoire est rehaussée par le charme de l’interprétation. On ne peut que se réjouir de savoir que l’ensemble des pièces du programme ont fait l’objet d’un enregistrement qui devrait paraître vers la fin de l’année.
INFORMATIONS
« Trésors du baroque espagnol », concert donné en l’église de Bellecombe-en-Bauge mercredi 12 août 2015, dans le cadre du 17e festival Musique et nature en Bauges.
Raquel Andueza, soprano
Ensemble La Galanía.
D’AUTRES ARTICLES