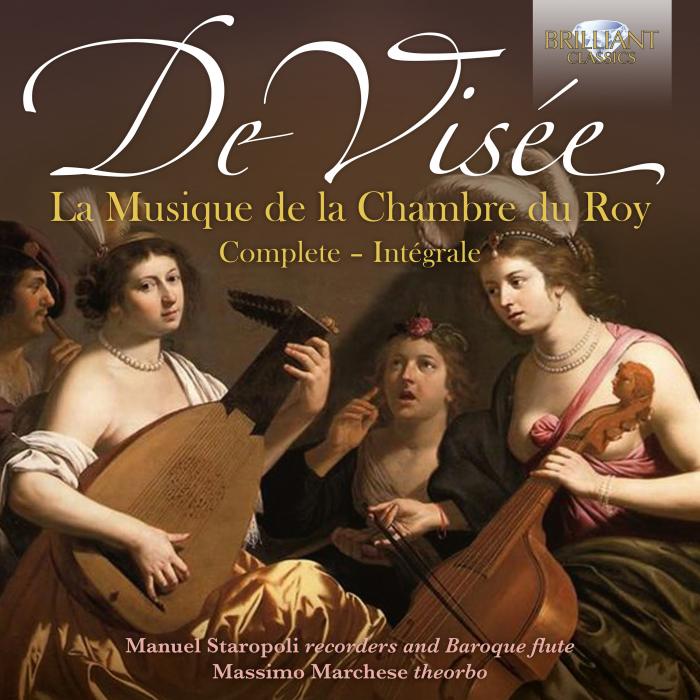par Loïc Chahine · publié mercredi 23 novembre 2016

« Toujours la foule et, en conséquence, toutes nouveautés ajournées1. » C’est en ces termes que le critique Jules Lovy, le 12 décembre 1858, constate le succès d’Orphée aux enfers d’Offenbach, créé presque un mois plus tôt, le 21 octobre, au théâtre des Bouffes-Parisiens. Il faut dire qu’une polémique était venu gonfler la publicité du spectacle : en 1858, en effet, se moquer si vertement de la mythologie et en particulier du mythe d’Orphée, si cher aux créateurs, poètes et musiciens, c’était s’attirer les foudres d’un pan de la critique, dont le plus éminent représentant fut alors Jules Janin, « prince des critiques », qui cria à la « profanation »… et donna à Offenbach l’occasion de lui répondre dans les journaux. Succès, donc, auréolé d’un léger parfum de scandale…
Mais succès avant tout dû à la qualité de l’ouvrage, bien entendu. Comme plus tard avec La Belle Hélène, Offenbach trouve avec Orphée un équilibre entre les pages parodiques, les rengaines et les couplets inoubliables (tout le monde connaît le fameux « galop infernal ») — et il n’est pas si facile d’écrire de la musique qui reste aussi bien dans la tête —, et d’autres moments qui témoignent de la finesse de son écriture musicale, comme le superbe chœur qui ouvre le deuxième tableau du premier acte, sur l’Olympe, avec ses ré de flûtes et de hautbois, répétés en noires pendant plus de quarante mesures, ou la chanson « Quand j’étais roi de Béotie », teintée d’une délicate mélancolie dont Offenbach a le secret.
Une plaisanterie disait que « Parsifal, c’est le genre d’opéras qui commence à 18h ; au bout de trois heures, vous regardez votre montre, il est 18h20 » ; on pourrait dire l’inverse d’Orphée aux enfers : cela commence à 20h, au bout de vingt minutes vous regardez… en fait, non, vous ne regardez pas votre montre : on ne s’ennuie pas. Il n’y a pas un temps mort, pas un air de trop, pas un dialogue trop long… Bref, c’est une œuvre qui méritait bien de devenir classique. On ne s’étonnera guère, dès lors, qu’aujourd’hui encore, le succès soit au rendez-vous.

Premier tableau
La qualité première de la mise en scène de Ted Huffman est de ne pas dénaturer l’ouvrage en voulant le rendre sérieux. Cela peut paraître anodin, mais à une époque où le comique est si peu estimé — ce que Guitry notait déjà : « Les gens ont de l’estime pour les larmes ; ils croient que le chagrin les anoblit. Ils méprisent leurs rires. » —, ne pas chercher à flatter la tendance au sérieux est une qualité. Bien sûr, il serait difficile de faire d’Orphée aux enfers une œuvre sérieuse, mais il faut s’attendre à tout, et l’on a souvent vu qu’une comédie devenait prétexte au sermon, prétexte à faire la leçon au spectateur. Ici, il n’en est rien, et si l’on nous demandait ce qui régnait au Théâtre Graslin pendant la représentation, nous pourrions répondre, comme Mercure à Jupiter, « c’était une grande gaieté ».
Ted Huffmann a transposé toute l’action dans une sorte de grand hôtel assez luxueux. Le premier tableau se passe dans un hall-salon où les gens passent ou s’installent ; le deuxième (l’Olympe) dans une salle où sont installés des dieux dorés mais énormes, façons bonshommes Michelin, qu’on imagine donc au-dessus de la précédente ; le troisième, enfin (les Enfers), dans une pièce type boîte de nuit au centre de laquelle est un bar. Parmi les dieux, tous énormes, nous l’avons dit, et presque incapables de se mouvoir, seul Pluton se distingue qui est « mince et fluet » et affublé d’ailes assez lugubres et d’une perruque blonde. La transposition fonctionne plutôt bien, décor et costumes (signés Clement & Sanôu) plaisent, bref, on est loin de la scénographie sombre et réduite à des costumes de ville et/ou symboliques, au monochrome et des jeux de lumières savant : voilà qui est réjouissant.
Les dialogues ont été sensiblement adaptés, mais sans excès. Ils ont surtout été réduits. Quelques allusions à l’actualité ont été glissées, en particulier dans l’acte olympien — qui s’y prête bien —, et s’avèrent tout à fait savoureuses car très bien amenées — elles « font épigrammes », aurait-on dit au xviiie siècle. Tout cela fonctionne bien. On aurait pu toutefois souhaiter une direction d’acteurs plus poussée, allant davantage dans le détail du texte.

Deuxième tableau
La distribution vocale est dominée par le Pluton de Mathias Vidal : timbre rond, projection exceptionnelle, intelligibilité du texte sans faille, et un certain talent d’acteur, le ténor rappelle qu’il est l’un des fleurons du chant français actuel. Franck Leguérinel, en Jupiter, n’a pas énormément à chanter, mais se distingue pas une présence d’acteur et une incarnation du texte très réussie. Face à ses deux galants, Sarah Aristidou s’en sort très bien en Eurydice, avec notamment un fort bel aigu ; la soprano incarne bien la jeune coquette, mais peu gagner encore un peu en jeu dans les passages chantés. L’Orphée de Sébastien Droy est fort bien chanté, le timbre est beau, mais le ténor pourrait affiner le jeu d’acteur ; dans l’absolu, le personnage campé correspond bien à ce qui doit lasser Eurydice. Parmi la cohorte des déesses (et de l’Amour), on notera que toutes les voix étaient belles, et on signalera en particulier le chant racé d’Anaïs Constans (Diane) et l’abattage scénique et vocal de Jennifer Courcier (Cupidon). Flannan Obé (John Styx) et Marc Mauillon (Mercure) sont honorables dans leur rôle, sans parvenir toutefois a les transcender. Doris Lamprecht, enfin, campe une opinion publique (en femme de ménage) très crédible, remarquable de tenue.
La direction de Laurent Campellone est efficace et sert le drame ; on en apprécie la précision, qui fait entendre quelques détails qui pourraient passer inaperçus. De notre place, toutefois (au parterre), il est à noter que l’orchestre couvrait parfois les voix. L’ensemble aurait sans doute gagné à trouver davantage de nuances. Signalons enfin le chœur d’Angers Nantes Opéra, très en forme.
En somme, on passe un bon moment avec cet Orphée aux enfers sans véritable faiblesse. « Et c’est si bon de rire ! — Et de n’importe quoi. — Surtout… — C’est de la gaieté qu’on avait en soi… — Sans le savoir2… »
1. Le Ménestrel, 12 décembre 1858, cité par Jean-Claude Yon, Jacques Offenbach, Gallimard, 2000, p. 213. Nous empruntons également à cet ouvrage les informations sur la polémique avec la critique. ↑
2. Sacha Guitry, Je t’aime, acte I, dans Théâtre complet, Club de l’honnête homme, 1973, t. IV, p. 270 ↑
INFORMATIONS
Jacques Offenbach : Orphée aux enfers
Nantes, Théâtre Graslin, mardi 22 novembre 2016.
Sarah Aristidou, Eurydice
Sébastien Droy, Orphée
Mathias Vidal, Aristée, Pluton
Franck Leguérinel, Jupiter
Doris Lamprecht, L’Opinion publique
Flannan Obé, John Styx
Jennifer Courcier, Cupidon
Lucie Roche, Vénus
Anaïs Constans, Diane
Edwige Bourdy, Junon
Marc Mauillon, Mercure
Mathilde Nicolaus, Minerve
Ted Huffman, mise en scène
Clement & Sanôu, décor, costumes et lumière
Orchestre National des Pays de la Loire
Chœur d’Angers Nantes Opéra
Laurent Campellone, dir.
Photos © Jeff Rabillon
D’AUTRES ARTICLES