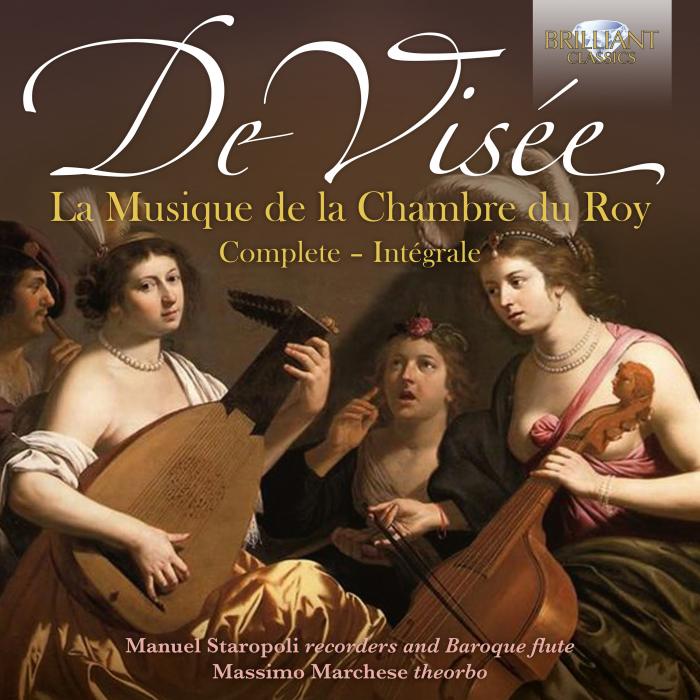par Loïc Chahine · publié lundi 24 aout 2015 · ¶¶¶¶

Alors que les prochains mois s’apprêtent à nous livrer de nouveaux fruits des célébrations de 2014 consacrées à Rameau (les enregistrements étant faits, il fallait encore les mettre en boîte et les éditer pour les publier), en voici un récolté tardivement de l’année Dauvergne, car Les Troqueurs qui constituent le premier CD du présent coffret ont été enregistrés en 2011. On ne peut que se réjouir des contretemps qui ont amené à retarder la parution de la version proposée par l’ensemble Amarillis de cet « opéra bouffon », car il se double du coup d’une seconde pièce du même genre, La Coquette trompée, qui donne lieu ici à un traitement tout à fait particulier. Les deux œuvres « ont ensemble étroit parentage1 », car elles ont été créées la même année 1753 et que leur forme est tout à fait similaire, quoique le lieu de représentation fût différent.
Pour bien saisir ce qui se joue avec Les Troqueurs, il faut se rappeler qu’en 1753, les esprits parisiens viennent d’être agités par la « Querelle des Bouffons », nouvel avatar de la controverse franco-française entre musique française et musique italienne qui avait commencé dès le milieu du xviie siècle3. Les spectateurs de 1752 eurent le choc de découvrir avec La Serva padrona de Pergolèse un genre italien relativement neuf pour eux, assez éloigné de l’opera seria qui paraissait si bizarre à Lecerf de la Viéville. Le genre, celui de l’intermezzo, n’était pas neuf, non plus que l’œuvre qui avait été créée en 1733, non plus d’ailleurs que la présence de ce type de pièces sur les scènes françaises, puisque la Comédie-Italienne sise à l’Hôtel de Bourgogne avait déjà donné plusieurs adaptations d’intermèdes italiens. Même sur la scène de l’Académie royale de musique, on avait donné en 1729 Baiocco et Serpilla de Giuseppe Maria Orlandini. Mais c’est seulement en 1752 que véritablement les Français se passionnèrent pour les « intermèdes italiens », pour diverses raisons qui tiennent sans doute en partie à l’essoufflement progressif de la tragédie mise en musique, qui a cependant encore quelques beaux jours devant elle avec la deuxième version de Zoroastre de Rameau en 1756 ou, dès 1752, Titon et l’Aurore de Mondonville — bien que l’œuvre soit surtout connue des spécialistes, ce fut en son temps un grand succès qui donnera lieu à plusieurs parodies, et même à une « parodie des parodies de Titon et l’Aurore ».
Malgré ces succès à venir, qui attestent que la tragédie en musique n’est pas encore morte, il semble que le moment est alors venu de l’émergence d’un nouveau genre. On pense au Devin du village de Jean-Jacques Rousseau, créé justement en 1752, et qui porte le sous-titre d’« intermède ». Le petit opéra est créé à Fontainebleau puis repris, à la faveur de l’engouement suscité par la Querelle des Bouffons, à l’Académie royale de musique en 1753. L’Opéra-Comique installé à la Foire Saint-Laurent en été compte bien ne pas demeurer en reste et tirer intérêt aussi de la vogue de la musique italianisante : c’est là que Dauvergne donne, aussi en 1753, Les Troqueurs. On a souvent dit c’était le premier opéra-comique, ce qui est faux à tous égards. Certes, la pièce a été donnée à l’Opéra-Comique qui avait rouvert, mais un théâtre appelé l’Opéra-Comique existait déjà auparavant, depuis le milieu des années 1710, même s’il a connu des éclipses. Certes, la pièce est composée presque entièrement d’airs originaux, mais il y avait déjà de la musique originale auparavant, et d’autre part dans la version primitive des Troqueurs, deux airs « populaires » (on parle de vaudevilles pour les désigner) étaient utilisés. Enfin, la forme elle-même, entièrement chantée, n’est pas l’alternance de parlé et de chanté que l’on considère généralement comme définissant le genre opéra-comique. Même si l’on objecte qu’on trouve dans la première moitié du xviiie siècle des opéras-comiques tout en vaudevilles, ils ne recourent pas au récitatif ; or dans Les Troqueurs, il y a des récitatifs.
Ce qui est certain, c’est que par sa musique à mi-chemin entre le grand style lyrique français illustré par Rameau, Mondonville ou Boismortier, et le style italianisant et même, on peut le dire, classicisant, Dauvergne ouvre la voix aux grands noms de l’opéra-comique de la deuxième moité du xviiie siècle — Grétry et Philidor en tête.
Les Troqueurs, on l’a dit, sont créés à l’Opéra-Comique, et, s’ils connaissent le succès, l’Académie royale de musique fait valoir son privilège, c’est-à-dire son monopole : ce n’est qu’elle seule qui a droit de faire des pièces entièrement chantées. Les représentations doivent donc être arrêtées. Dauvergne ne rencontrera pas le même problème avec La Coquette trompée puisque la pièce est commandée par la Cour et créée à Fontainebleau, mais la pièce ne sera jouée, au total, qu’un petit nombre de fois — ce qui est bien injuste eu égard à sa qualité. La forme des deux œuvres est sensiblement la même, si ce n’est que le compositeur se donne plus de liberté dans La Coquette trompée, se permettant par exemple des airs avec un da capo abrégé, où la deuxième partie (avant la reprise, donc) est en fait un récitatif, s’autorisant aussi une écriture instrumentale plus brillante. Il n’est pas rare qu’un air s’enchaîne avec un autre air ou une ariette, et les récitatifs sont souvent très brefs, ce qui confère à l’ouvrage une certaine densité, malgré son livret relativement pauvre. Il est certain que La Coquette trompée est un aboutissement qui conduira ensuite à La Vénitienne (1768), comédie en musique créée à l’Académie royale de musique et de dimensions plus vastes — trop vastes, peut-être.
Mais ce que propose, à côté des Troqueurs, l’ensemble Amarillis, ce n’est pas exactement La Coquette trompée mais un ouvrage intitulé La Double Coquette, lequel est basé sur La Coquette trompée de Dauvergne mais contient également des « additions » dues au compositeur Gérard Pesson (né en 1958). Le texte en a été confié au poète Pierre Alferi, qui se glisse donc à côté de Charles-Simon Favart, auteur du livret « d’origine ». Additions, de quoi s’agit-il exactement ? Il convient d’abord de préciser que la quasi-totalité de la musique de Dauvergne et du texte de Favart sont préservés, à l’exception du vaudeville final, qui est altéré. Pesson intervient véritablement dans la partition de Dauvergne, çà et là en ajoutant quelques instruments dans un récitatif, le plus souvent en intercalant une nouvelle pièce, toujours brève (la plus longue dure 1’21). À quelques endroits, Pesson et Alferi ont choisi simplement de mettre du texte chanté sur une musique instrumentale — c’est le cas, à la fin de l’œuvre, dans le second menuet, qui donne l’occasion d’un superbe trio vocal. Il faut enfin signaler qu’un prologue d’une dizaine de minutes a été ajouté. C’est ce prologue qui m’a le moins convaincu.
Le travail de Gérard Pesson est remarquable à plus d’un égard. Il a su manier le matériau de Dauvergne lui-même, par exemple en insérant dans une de ses additions (no 5) le motif mélodique d’une danse de La Coquette trompée (danse que l’on entend aussi en version originale à sa bonne place) et en le modifiant, en usant parfois de pastiche, et en composant une musique variée, très « recherche contemporaine » par endroits, plus jazzy à quelques moments (par exemple le no 11), musique qui contient d’indéniables réussites et qui se fond avec habileté à côté de celle de Dauvergne — les transitions sont généralement très bien pensées. On notera aussi quelques citations, les unes manifestes (« Un jour, mon prince viendra »), les autres plus discrètes (on reconnaît là un peu de la habanera de Carmen, ici un peu de « Lieux funestes » de Dardanus). On pourrait disserter à l’infini sur le fait d’insérer des additions contemporaines sur instruments anciens dans une œuvre ancienne. Nous ne le ferons pas, et nous nous contenterons d’indiquer qu’ici, ça fonctionne très bien, justement parce que Gérard Pesson a su se faire le collaborateur de Dauvergne, tantôt en se glissant dans ses pas, ou plutôt ses notes, tantôt en ajoutant sa touche personnelle. Les plus sceptiques écouteront le menuet-trio déjà cité et la transition entre la fin du « Récit, mélodrame et arioso » de Pesson (piste 23) et la première phrase du récitatif de Dauvergne qui suit, « Remettez en mes mains les gages de ses feux » — transition d’une redoutable efficacité et qui vient même rehausser l’intérêt de la phrase de récitatif en question.
Je suis un peu plus sceptique quant au texte, qui, certes, a des trouvailles amusantes, mais est loin d’avoir la même exigence que celui de Favart, du moins à mes yeux. Je regrette surtout qu’il appuie avec une certaine lourdeur sur les questions de genre — c’est très à la mode, semble-t-il. Pour résumer l’intrigue La Coquette trompée, Florise est délaissée par Damon, lequel s’est amouraché d’une certaine Clarice ; Florise se déguise donc en homme pour séduire Clarice. Il y a bien là une idée de confusion des genres — on retrouve la même chose dans La Vénitienne d’ailleurs, mais aussi dans d’autres pièces — mais c’est sans s’y attarder ; je trouve donc regrettable que les additions textuelles mettent autant l’accent dessus — cela dit, peut-être faut-il cela aujourd’hui, la délicatesse n’étant plus ce qu’elle était, o tempora, o mores, etc., etc., complétez vous-mêmes les lieux communs et reprenons notre propos.
Cela n’empêche pas la sauce de prendre, et de fait, La Double Coquette fonctionne plutôt mieux, à mon sens, que Les Troqueurs, et ce pour plusieurs raisons. Si la version ici proposée des Troqueurs se présente comme fidèle à l’originale, il faut toutefois remarquer que la plupart des danses qui se trouvaient originallement dans le « Ballet » final ont été pour la plupart disséminées au cours de l’œuvre, entre les scènes. Certes, ces danses sont excellemment interprétées, la vivacité dramaturgique de l’œuvre en prend toutefois un petit coup. Notons en passant que les trois menuets de ce divertissement final ont été omis.
Il faut aussi reconnaître que la musique des Troqueurs est moins fine et moins variée que celle de La Coquette trompée. De plus, Amarillis semble beaucoup plus à l’aise dans La Double Coquette. Il est indéniable que quelques violons supplémentaires auraient fait bon effet, l’équilibre entre les hautbois et les cordes étant parfois un peu mis à mal — alors qu’il est tout à fait bon à d’autres endroits. Dans La Double Coquette, le son de l’ensemble Amarillis s’est affermi et vivifié — signalons qu’il s’agit d’un enregistrement live, ce qui ne transparaît que très peu dans la prise de son hédoniste d’Hannelore Guittet, plus ample que celle d’Alessandra Galleron pour Les Troqueurs.
La relative impefection des Troqueurs transparaît surtout dans les premières scènes, que j’ai trouvées un peu molles, du moins dans les ariettes — dans les deux œuvres, les récitatifs sont idéaux et témoignent d’un vrai sens du théâtre — on imagine que le clavecin et la co-direction de Violaine Cochard n’y sont pas pour rien. Au demeurant, cela n’empêche pas les Troqueurs, surtout dans leur deuxième moitié, de receler de très beaux moments. Alain Buet, qui semble un peu sage, comme Amarillis d’ailleurs, au début, semble « se lâcher » davantage dans l’ariette « Sa nonchalance ». Benoît Arnould a nettement moins à chanter, d’ailleurs il n’a qu’une seule ariette, « Pauvre Lucas », qui est l’une des grandes réussites de ces Troqueurs. Chez les dames, c’est à Jaël Azzaretti que revient le plus joli rôle. La voix est claire, les aigus parfois un peu tirés, mais son ariette « D’un amant inconstant » est assurément l’un des plus beaux moments du CD. La voix se marie très bien avec celle d’Isabelle Poulenard, qui n’a pas d’air solo mais dont la “performance” dans les ensembles et les récitatifs est tout à fait agréable.
On retrouve également Isabelle Poulenard dans La Double Coquette, c’est même elle qui tient le rôle central. La voix semble un peu plus instable, avec un vibrato par endroits un peu envahissant qui a tendance à brouiller la netteté de la ligne (exemple dans l’air « Un infidèle », piste 10). Il n’y a toutefois rien là de rédhibitoire, elle fait d’ailleurs montre d’un bon sens du théâtre, mais il est certain qu’elle pâlit du voisinage de Maïlys de Villoutreys : timbre clairement affirmé, un peu semblable à un beau cristal travaillé, taillé, articulation impeccable, coloratures précises, variété des couleurs, variations intéressantes dans les da capo, mais jamais outrancières, bref, tout pour plaire, surtout si l’on ajoute qu’elle semble avoir exactement la tessiture du rôle et qu’elle ne manque pas d’une certaine classe. Face à elles, le « méchant » Damon est campé par Robert Getchell, en grande forme. Il peut se targuer, lui aussi, d’un excellent rendu du texte, dont aucun mot ne se perd, et d’une aisance absolument confondante, avec en particulier un très beau registre aigu. Il m’a paru parfaitement à sa place dans ce répertoire, où son timbre plutôt clair fait merveille.
Si l’ensemble Amarillis semblait un peu “marcher sur des œufs” dans Les Troqueurs, sa performance dans La Double Coquette est extrêmement convaincante. Le discours est ferme, les timbres souvent enchanteurs ; j’aime beaucoup le hautbois d’Héloïse Gaillard, les cors sont bien mis en valeurs, par exemple dans le menuet du divertissement final, les violons redoublent de virtuosité sans rechigner… Au total, un petit orchestre plein de vivacité et de charme.
Qui n’a pas de répulsion absolue pour tout ce qui s’approche de la musique dite contemporaine doit connaître ce coffret et goûter cette Double Coquette, qui offre un regard musical original et fin sur une œuvre ancienne, une œuvre ancienne, de plus, d’un haut intérêt. Passé un petit effort d’adaptation, le jeu en vaut très largement la chandelle. Gageons que ceux qui auront la chance de voir cette Coquette sur scène en seront tout aussi enchantés.
1. La Fontaine, « La Tortue et les deux Canards », Fables, livre X, fable 2. ↑
2. Pour davantage de précisions, on se reportera à la monographie de Benoît Dratwicki, Antoine Dauvergne (1713–1797) Une carrière tourmentée dans la France musicale des Lumières, CMBV / Mardaga, 2011. ↑
3. Signalons, au milieu du xviie siècle, la mascarade Les Plaisirs troublés qui se moque de l’insertions de récits italiens dans un ballet français, en l’occurrence L’Amour malade de Lully, et le Ballet de la Raillerie, en 1659, dans lequel la Musique Française et la Musica Italiana sont mises en scène dans un dialogue où elles se reprochent mutuellement leurs défauts. ↑
La Double Coquette, fin de la sc. 2, début de la sc. 3.
La Double Coquette, menuet 2 (avec addition).
INFORMATIONS
Antoine Dauvergne : Les Troqueurs, livret de Jean-Joseph Vadé (1753).
Jaël Azzarretti, Margot (soprano).
Isabelle Poulenard, Fanchon (soprano).
Alain Buet, Lubin (baryton).
Benoît Arnould, Lucas (baryton).
Antoine Dauvergne et Gérard Pesson : La Double Coquette, livret de Charles-Simon Favart (1753) et Pierre Alferi (2014).
Maïlys de Villoutreys, Clarice (soprano).
Isabelle Poulenard, Florise (soprano).
Robert Getchell, Damon (ténor).
Ensemble Amarillis
Héloïse Gaillard, hautbois, flûte et direction
Violaine Cochard, clavecin et direction.
1 CD, 45’05 + 76’26 NoMadMusic, 2015.
D’AUTRES ARTICLES