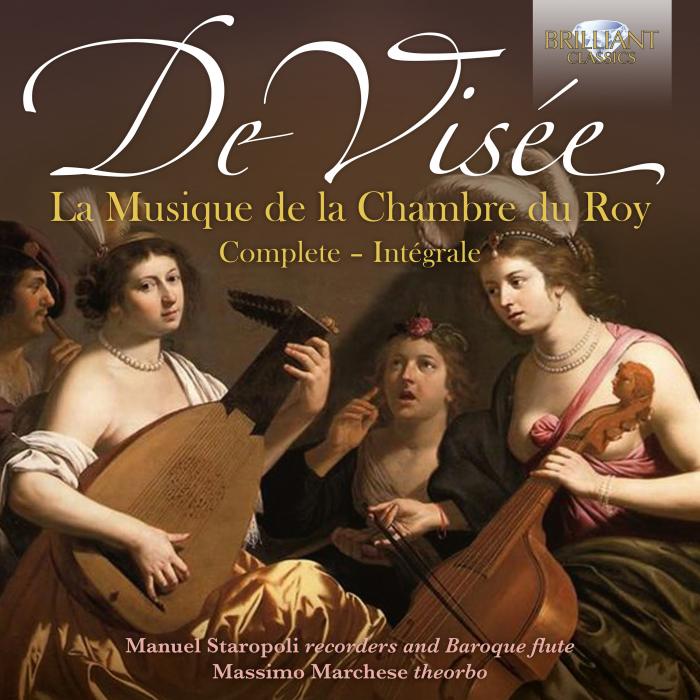par Loïc Chahine · publié mercredi 6 septembre 2017

C’est très vraisemblablement en 1681 qu’Alessandro Stradella (1639–1682) a achevé son opéra La Doriclea. Dans une lettre adressée le 24 mai à Flavio Orsini, duc de Bracciano, Stradella évoque la préparation d’ « un petit opéra de cape et d’épée à six personnages ». — description qui correspond bien à l’intrigue de la Doriclea dans laquelle le fer « se montre deux fois », et où le nœud de l’intrigue est une scène de nuit. De plus, les chanteurs que le compositeur évoque peuvent parfaitement correspondre à la distribution requise pour la Doriclea : Margherita di Bologna et « une de ses sœurs » ont dû jouer les rôles de Doriclea et Lucinda, le castrat Cortoncino de Vienne, celui de Fidalbo, la basse Petriccioli, « bouffe » d’après la lettre, le rôle comique de Giraldo auquel répond, pour Delfina, « une vieille de Milan » (le rôle n’aurait donc pas tenu par un ténor, mais bien par une femme) ; enfin Pietro Santi (également de Vienne), nom inconnu de nous, a dû être le ténor à qui revenait le rôle de Celindo. Si l’on a parfois attribué le livret à Flavio Orsini, il semblerait étrange que Stradella, dans sa lettre, n’entretienne pas plus longuement son librettiste de leur œuvre commune ; cette hypothèse semble donc devoir être écartée… en attendant qu’une meilleure se présente.
Cet opéra « de cape et d’épée » raconte l’histoire d’un quiproquo. Parce qu’elle ne peut pas épouser Fidalbo, qu’elle aime, Doriclea décide de s’enfuir avec lui une fois la nuit venue. Mais pendant la scène de nuit, Doriclea se trompe et part avec Celindo, lui-même l’amant de Lucinda. Il faut ensuite bien du temps et bien des explications pour que tout cela se dénoue, et l’intrigue est également traversée par les aventures des deux personnages bouffes, Delfina et Giraldo.
Cette Doriclea n’était pas tout à fait donnée en « première recréation mondiale », puisqu’Andrea De Carlo l’avait déjà recréée dans le cadre du « Stradella Y(oung)-Project » en 2015. C’est cette fois une équipe aguerrie qui s’empare de la partition. Au concert, de larges coupures ont été effectuées afin de faire tenir l’ensemble en deux heures et demie — sans entracte, mais l’on est fort bien porté d’un bout à l’autre, fait en soi remarquable ; le disque, en revanche, puisque l’équipe, dès la fin du concert, rejoignait son lieu d’enregistrement, présentera une version intégrale de l’œuvre, ce qui est fort heureux car, outre que cela fera davantage de musique, cela rendra le livret à sa cohérence dramatique, ici quelque peu mise à mal. Signalons d’ailleurs qu’il ne s’agissait pas d’une version mise en scène, mais seulement mise en espace par Guillaume Bernardi. Si le travail minimaliste convenait bien aux oratorios qu’il avait mis en espace à Nepi, l’urgence dans laquelle le travail a été mené ici ne lui a pas permis d’avancer suffisamment de propositions pour livrer une mise en espace véritablement aboutie. Toutefois, les quelques effets proposés aident grandement à saisir l’intrigue, et c’est déjà salutaire. Il est néanmoins regrettable que cette production n’ait pu reprendre les costumes historiques réalisés par Isabella Chiappara Soria en 2015 pour le Stradella Y-Project. Un jour, peut-être, les délais de montage des productions redeviendront raisonnables et les projets pourront être menés à bien dans de meilleures conditions. Quoi qu’il en soit, l’on ne peut que se réjouir d’entendre cette œuvre qui figure parmi les dernières de Stradella.
La musique, comme toujours, pourrait paraître assez terne de prime abord. Point de coloratures brillantes comme dans les opere serie du xviiie siècle, point de bruit et de fureur, mais des finesses, de très beaux et nombreux duos, des lamenti, ici un fugato, là un changement de mesure inattendu. Comme souvent avec Stradella, il faudra plusieurs écoutes pour apprivoiser les richesse de une partition, toutefois moins déroutante que celles de plusieurs oratorios.
On ne présente plus le remarquable travail d’Andrea De Carlo, certainement le meilleur connaisseur de l’œuvre de Stradella aujourd’hui. C’est après avoir fréquenté des œuvres de moindre longueur qu’il s’empare de la partition, en trois actes, de La Doriclea, à la tête, non plus de son ensemble Mare Nostrum, mais d’Il Pomo d’Oro — où l’on retrouve néanmoins des musiciens qui ont déjà joué sous sa direction, comme Simone Vallerotonda (archiluth et guitare), Daniel Zapico (théorbe) ou Andrea Buccarella (clavecin). L’effectif, d’ailleurs, se concentre sur une ample basse continue (sept musiciens), n’y ajoutant que deux violons. Ces, ces deux violons ne doivent pas être oubliés, et Zefira Valova et Evgeny Sviridov, au jeu parfaitement homogène, savent se montrer, en particulier, très sensuels. Mais il paraît assez logique que la basse s’impose davantage si l’on se souvient que l’essentiel du travail instrumental est concentré dans l’accompagnement des chanteurs ; quelques airs présentent des ritournelles, quelques autres un véritable accompagnement des deux violons, mais dans la plupart, c’est bien à la basse continue que le rôle « d’orchestre » revient. La comparaison avec l’orchestre comme protagoniste du drame s’impose, car on a véritablement l’impression que ce continuo fait jeu égal avec les chanteurs. D’ailleurs, Andrea De Carlo ne traite pas cette ligne de basse comme un simple soutien, un accompagnement qui ne serait destiné qu’à mettre en valeur, mais, fort de son expérience avec trois oratorios où il n’y avait que la basse continue et les chanteurs, il fait véritablement vivre cette basse, il y cherche (et trouve) des couleurs, des rythmes, et met particulièrement bien en valeur les passages anguleux de l’écriture de Stradella. Comme dans les précédentes réalisations, avec toutefois un peu plus de théâtre — l’opéra l’appel — mais sans excès, il fait ce qu’il faut : ni plus, ni moins.
Du côté de la distribution, les deux jeunes premières se distinguent particulièrement. La soprano Emöke Baráth, dans le rôle titre, allie une émission d’une remarquable clarté à un beau timbre, une grande facilité à une très bonne articulation. Le dévoilement de sa véritable identité, vers la fin de l’acte III (« Ferma Fidalbo omai, son Doriclea ») fut assurément l’un des moments les plus dramatiquement réussis de la soirée. Mais le personnage de Lucinda donne au mezzo-soprano de Giuseppina Bridelli bien plus d’affetti, du désespoir à la rage (« Palesi a me già », acte II) ; lui reviennent également deux superbes duos, l’un avec Fidalbo (acte II), l’autre avec Doriclea déguisée en Lindoro (acte III), tous deux fort réussis. Et Giuseppina Bridelli est le genre de chanteuse qu’on ne se lasse pas d’entendre. Sublime dans la Passio secundum Johannem de Scarlatti, la voici théâtrale, voluptueuse et tourmentée.
On n’apprécie pas moins le Celindo au phrasé long et aérien, au chant très équilibré et toujours attentif à ce qui l’entoure (très bel air « Che pena non da », acte I) de Luca Cervoni. La voix est claire et puissante, sans jamais être forcé, et le style ne souffre d’aucun défaut. Le baryton-basse Riccardo Novarro, dans le rôle bouffe du courtisan Giraldo, se révèle progressivement, devenant de plus en plus comique. Si le grave n’est pas toujours parfaitement audible — le rôle étant sans doute un peu grave pour le chanteur —, le chant est toujours distingué. C’est la même distinction qui anime l’excellente Gabriella Martellacci, contralto, dans le rôle de la vieille Delfina ; elle fait un peu de théâtre en scène, mais jamais au détriment de la musique — ce n’est « qu’ » une version mise en espace — et chante aussi bien qu’elle évoque.
Le point noir de la distribution est le contre-ténor Xavier Sabata (Fidalbo). Le timbre est discret, peu marqué, mais on pourrait discuter des heures sur ce qui nous touche ou nous déplaît et là n’est pas le problème : c’est plutôt la puissance qui fait défaut ; le plus souvent, et en particulier dans le grave de la tessiture, on ne l’entend pas vraiment, on le discerne, on le devine. Il y a certes quelques beaux moments, dans les airs lents, dans le duo avec Lucinda à l’acte II, mais dans l’ensemble, la déception prime.
Peut-on rester au plus près du texte musical sans pour autant tomber dans la fadeur ? Une fois de plus, Andrea De Carlo et son équipe montrent qu’il n’est point besoin d’ajouter aux partitions, mais d’y chercher et de mettre en valeur ce qui s’y trouve. C’est ainsi que cette Doriclea trouve le point d’équilibre entre fidélité à la source et véritable concert, performance vivante et prenante. Le disque est d’ores et déjà attendu avec impatience.
INFORMATIONS
Concert donné en ouverture du Festival Barocco Alessandro Stradella, à Rome, Auditorium Parco della Musica, le 2 septembre 2017.
D’AUTRES ARTICLES