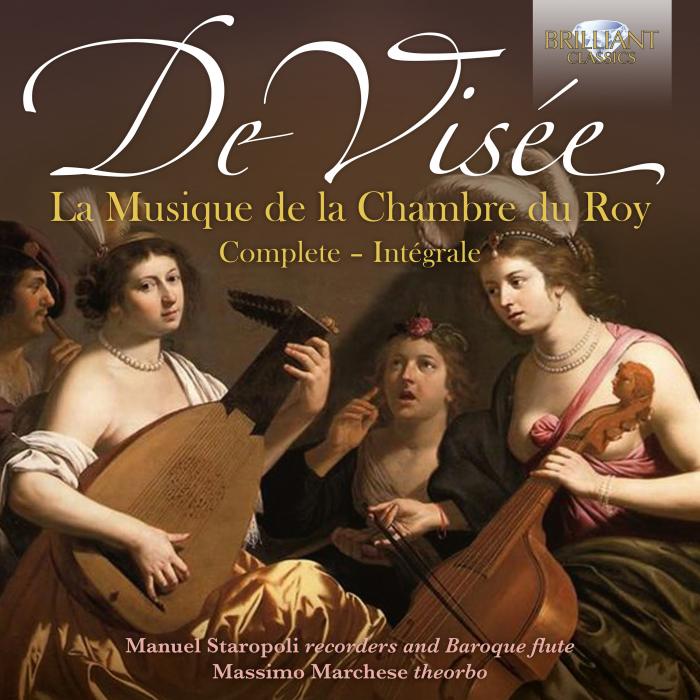par Loïc Chahine · publié lundi 1 juin 2015
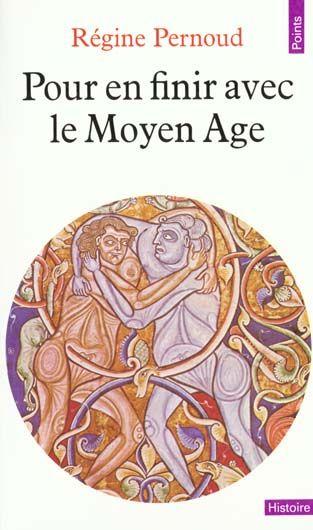
Le titre du bouquin ne m’avait pas trop plu : Pour en finir avec le Moyen Âge — veut-on en finir ? L’idée n’est guère jolie. Mais ayant croisé deux fois le livre, m’étant dit qu’un ouvrage accessible qui allait contre les idées reçues sur une période — quelle qu’elle soit d’ailleurs — et ce avec une certaine concision, je me suis laissé tenter. Las, mal m’en a pris.
En effet, dès la première page (la page 5, une fois passée le faux-titre et le reste), le festival est annoncé avec la note 1 :
« Moyen Âge devrait toujours être entre guillemets ; nous n’adoptons ici l’expression que pour nous conformer à l’usage courant.
Et pourquoi donc « Moyen Âge » devrait-il être entre guillemets ? On n’a pas l’explication. On notera cependant que « médiéviste », trois mots plus loin, n’a pas de guillemets, lui, alors même que c’est en fait la même chose mais en latin et affublé du suffixe -iste. Si Régine Pernoud n’explique pas pourquoi elle veut qu’on mette Moyen Âge entre guillemets, on le subodore : cette expression n’est pas assez flatteuse pour “son” époque — il aurait été tentant d’y voir simplement l’idée que chaque nom de période devrait l’être, n’était pas forcément représentatif de tous les aspects, mais elle se garde bien de mettre « Renaissance » ou « âge classique » entre guillemets, alors même qu’ils l’eussent bien plus mérité que « Moyen Âge ». Aura-ton l’explication de pourquoi le Moyen Âge est appelé « Moyen Âge » ? Non. Pourtant, il n’y rien là d’infamant : cela ne veut pas dire autre chose que l’époque qui se trouve au milieu, entre deux autres. On notera aussi que même si elle rechigne à accepter cette dénomination, Régine Pernoud n’a pas cure d’en proposer d’autre. Lecteur, démerde-toi.
Je passe sur le début de l’introduction (ou du premier chapitre), en admettant qu’il soit bienvenu, pour un premier chapitre, de vouloir frapper fort, mais de nombreux points mériteraient une discussion réglée. Arrivons-en tout de suite à la page 13 — même pas dix pages après le début, donc — et à sa note. Régine Pernoud s’en prend au langage courant qui associe Moyen Âge et barbarie, incivilisation, et voici ce qu’elle écrit :
« Des exécutions d’une sauvagerie presque médiévale », écrivait récemment tel journaliste. Savourons ce : presque. Bien sûr, au siècle des camps de concentration, des fours crématoires et du Goulag, comment n’être pas horrifié par la sauvagerie des temps où l’on sculptait le portail de Reims ou celui d’Amiens !
Bien sûr, de tels raisonnements sont courants. Pour autant, ont-ils leur place dans des ouvrages sérieux ? Régine Pernoud, pour comparer deux époques, met sur le même plan des faits d’armes et des faits d’arts — qui n’ont rien à voir. Il est assuré que le journaliste qui résumait, peut-être, le Moyen Âge à une ère de sauvagerie ne faisait pas haute œuvre, mais qu’en est-il de celle qui résume le XXe siècle à Hitler et Staline ? C’est presque comme dire : « Le feu, cette force merveilleuse dont le XIXe siècle a fait des machines à vapeurs, comme les locomotives, tandis que que le Moyen Âge l’utilisait à ériger tant de bûchers pour ceux qu’il jugeait hérétiques ». Ça vous semble complètement con ? À moi aussi.
Ce trait est assez représentatif de la manière de procéder de Régine Pernoud : pour défendre “son” Moyen Âge, elle passe une bonne partie de ses pages à descendre les autres époques, à les caricaturer. Ainsi, l’époque moderne, ou l’âge classique et la Renaissance, n’ont créé que sous le joug de l’imitation de l’antique, « pendant quatre siècles environ » dit-elle. C’est aller un peu vite en besogne, c’est oublier, par exemple, la querelle des Anciens et des Modernes et tous ses avatars. Au demeurant, les approximations, les imprécisions ne sont pas rares. Ainsi, elle dit le roman « inconnu de l’Antiquité classique » — Héliodore et Pétrone, retournez vous coucher, vos œuvres ne sont rien.
Parle-t-on de théâtre ? Allons page 37 :
Au xvie siècle, pas plus que les arts, les lettres n’échappaient au postulat d’imitation [de l’Antiquité] ; là encore, il fallait se conformer aux règles fixes du genre gréco-romain. Une tragédie devait nécessairement comporter les trois unités, de temps, de lieu, et d’action ; tout écart était sévèrement jugé.
C’est vite dit. D’abord, parce que Régine Pernoud laisse entendre que le théâtre se limite à la tragédie, ce qui n’est pas le cas. Ensuite, la règle des trois unités et certes énoncées au début de la Renaissance en Italie, mais elle ne trouve son application qu’au gré de discussions relativement passionnées dans les années 1630, qui ne sont pas tout à fait le XVIe siècle. Peut-on vraiment dire au demeurant qu’elles sont les règles fixes du genre gréco-romain ? Qu’en est-il des chœurs, des divisions, etc. ? Régine Pernoud jette aux orties tous les genres différents du genre classique (tragi-comédie, pastorale dramatique, tragédie en musique) pour pouvoir ensuite dire « regardez, tout n’est que classicisme ».
Entre les genres, on maintenait une séparation rigoureuse : comédie d’une part, tragédie de l’autre. Et pour celle-ci, jugée « noble », il était obligatoire d’aller chercher ses sujets dans l’Antiquité.
Oui, forcément, si on ne parle que des genres les plus contraints, si on éjecte ce qui n’est ni tragédie ni comédie, mais un peu des deux…
Dans la poésie plus courante, bergers d’Arcadie, nymphes, satyres et autre faune, évolueront désormais, tout comme dans les tableaux de Poussin.
Il est bien connu que la poésie du xviie siècle ne parle que de cela. La querelle entre le sonnet d’Uranie et le sonnet de Job ? Bagatelle ! D’ailleurs, il ne doit pas y avoir de sonnet de Job. Le Melon de Saint-Amant ? Baste, cela n’existe pas. Et puis il faudrait encore se demander si les noms pastoraux ne cachent pas aussi d’autres choses : ils ne sont que des noms, des masques pour ne pas nommer, parce que l’on croit à une certaine universalité d’une part, parce que d’autre part quand on écrit « Philis, tout est foutu, je meurs de la vérole », c’est tout de même moins violent de mettre un nom de convention que celui de la vraie personne qui a contaminé le poète. Régine Pernoud, qui veut que l’on appréhende le Moyen Âge dans sa richesse, dans sa diversité, résume les autres périodes à leurs grands traits, non sans les affubler de qualificatifs méprisants et moralisateurs (l’Essai sur la peinture de Diderot est par exemple qualifié de « code du pompiérisme »). Même en ne prenant que le Lagarde et Michard on aurait une vision plus vaste de la littérature que celle qu’elle en entrevoit.
Veut-on parler de poésie ? La page 38 nous éclairera :
Il avait même été question au xvie siècle de réduire le vers français aux règles de la prosodie et de la métrique antiques, fondées sur une accentuation qui, justement, n’existe pas dans la langue française.
D’abord, l’accentuation existe dans la langue française (l’accent y est terminal), et joue un rôle, certes modeste, dans la métrique, puisqu’on compte en réalité les syllabes jusqu’à la tonique (à l’exclusion des post-toniques, c’est-à-dire, concrètement en français, des -e “féminins” — mais rappelons que plusieurs traités expliquent bien qu’il y a des alexandrins de 12 syllabes (les masculins), et d’autres de 13 (les féminins), avant de faire la distinction). Ensuite, la métrique antique n’est justement pas fondée sur l’accentuation mais sur la longueur syllabique — ce qui n’a d’ailleurs pas été sans poser certains problèmes en latin puisque c’est un système qui était copié par les Romains sur les Grecs mais qui ne s’adaptait pas si parfaitement à leur langue. Or, les essais — car ce sont bien plutôt des tentatives que des volontés de législation — entrepris au xvie siècle, par exemple par Baïf, de vers mesurés à l’antique, tente de reproduire cette donnée, la donnée quantitative, la longueur, qui, alors, existe en France. Je ne sais plus quel traité de prononciation du xviie siècle (Grimarest ou Bacilly, il me semble) explique que ces longueurs font partie de la bonne prononciation et que justement, on reconnaît les provinciaux entre autre au fait qu’ils ne font pas exactement les mêmes longues et les mêmes brèves.
On pourra se demander, alors, pourquoi ces essais ont été si peu suivis, pourquoi la métrique française n’a pas suivi le chemin de la métrique à l’antique ? Peut-être bien, d’abord, parce qu’il y avait déjà une tradition du vers français qui ne s’était pas fondée sur les quantités prosodiques mais sur le nombre de syllabes métriques et la rime — peut-être aussi, c’est une hypothèse qui a été formulée par un spécialiste de la versification — que justement, dans la mesure où il y avait des disparité régionales sur la prononciation des longueurs même à l’intérieur de la langue française (et sans considération, donc, des dialectes régionaux), cela ne pouvait servir à fonder un système métrique, ce serait trop fragile.
Ceci, en apparence, nous éloigne de Pour en finir avec le Moyen Âge, mais en fait, Régine Pernoud parle juste après la métrique de l’orthographe, vain souci, « fantaisie des pédants de la Renaissance ». Là encore, elle n’évoque pas une des raisons fondamentales : la volonté d’uniformisation. Qu’on ait choisi d’uniformiser en se référant à l’étymologie, certes, est discutable — mais il est malhonnête de passer sous silence la volonté d’uniformiser, de créer une langue qui ait quelque stabilité. Sans parler du fait qu’elle évoque les « redoublements de m et de n » comme s’ils n’avaient aucune influence sur la prononciation, alors que c’était le cas à l’époque, puisqu’ils pouvaient influer sur le timbre (grammaire, par exemple, se disait vraisemblablement, au xviie siècle, gran-mèr, il y a un jeu là-dessus dans un ballet des Jésuites où à côté des déclinaisons et des conjugaisons il y a une Grand-Mère qui est évidemment la grammaire) et sur la quantité syllabique déjà évoquée.
On peut certes se demander quel sens cela a, aujourd’hui que la prononciation est à peu près uniformisée, de continuer à uniformiser l’orthographe selon des règles qui paraissent arbitraires plutôt que sur un fait de langue contemporain et accessible — la façon dont on dit. Eh, bien ! ne fût-ce que parce qu’en réformant entièrement l’écriture de la langue, on rendrait encore plus difficile l’accès aux textes anciens, qui, eux, ont été écrits dans une tradition orthographique à peu près constante — même si pas complètement — depuis le XVIe, ou au moins le xviie siècle. Pour faciliter l’apprentissage immédiat, on rendrait quasiment toute une culture inaccessible.
Ceci nous amène à une autre remarque de Régine Pernoud : les textes du Moyen Âge ne sont pas, ou presque pas enseignés, on fait généralement commencer la poésie à Villon. Prenons les choses autrement : ne fait-on pas plutôt commencer l’étude de la littérature au moyen français, c’est-à-dire à la langue de la Renaissance ? Eh oui, qui veut lire un texte du Moyen Âge se heurtera à ce problème : la langue n’est pas la même. L’ancien français est très éloigné de nous, comme disons le grec ancien du grec moderne — c’est très approximatif comme comparaison, je m’en excuse, mais concrètement, ce n’est pas parce que vous savez commander une bière à Athènes et y acheter du shampooing que dans la foulée, vous allez lire Sophocle et Démosthène. De plus en plus, aujourd’hui, les programmes des classes de français commencent d’ailleurs au xviie siècle, et non au xvie, parce que la langue classique est encore moins difficile que le moyen français de “la Renaissance”, que la langue de Molière, de La Bruyère, est plus proche de nous que celle de Montaigne, Du Bellay ou Rabelais — encore que pour la poésie, on est invité à la traiter « du Moyen Âge à nos jours ».
Si elle s’en prend à l’école qui, cette vilaine, n’apprend pas la littérature du Moyen Âge aux chères têtes blondes, Régine Pernoud n’épargne pas non plus les bibliothèques qui, en son temps, possèdent sept exemplaires en rayon de la Pharsale de Lucain en latin, et pas un seul de Tristan et Yseut ou de Chrétien de Troyes. Ce point mérite d’être remis au goût du jour, car aujourd’hui, peu de gens lisent le latin — ce qui devait déjà être le cas en 1960 au demeurant. Sortons de la bibliothèque, allons à la librairie. Trouvera-t-on Chrétien de Troyes et Tristan ? Oui, en ancien français, en français moderne, et en bilingue, dans plusieurs éditions (Le Livre de Poche, H. Champion, G.F., Gallimard). Trouvera-t-on la Pharsale ? Il n’y a pas de traduction “récente” en français.
À propos de la culture de l’Antiquité, Régine Pernoud a soin de nous rappeler que le Moyen Âge ne l’ignorait pas, et de citer l’exemple de Bernard de Clairvaux qui « manie lui-même une prose toute nourrie de citations antiques », et entre autres de vers du satiriste latin Perse. Soit. Elle ajoute :
on n’oserait affirmer que cet auteur-là [Perse] ait fait partie du bagage de tout intellectuel aux temps les plus classiques.
Le raisonnement est infiniment fallacieux : on passe d’un auteur isolé, Bernard de Clairvaux, pour le Moyen Âge, à « tout intellectuel » pour les époques ultérieures, comme si au Moyen Âge « tout intellectuel » connaissait Perse. Et quand bien même ce serait le cas, ce n’est pas parce qu’aujourd’hui peu de gens le connaissent, ce n’est pas parce que Régine Pernoud l’ignore, que les hommes de « culture classique », comme elle se plaît à les désigner, ne le connaissaient pas. Ainsi, Rousseau, dont on sait qu’il n’a reçu que des rudiments d’instruction, le connaissait, puisque c’est lui qu’il cite au début des Confessions : oui, « intus et in cute » est une citation de Perse. Que se passerait-il maintenant si moi j’écrivais :
Quand Jean-Jacques Rousseau commence ses Confessions et qu’il veut ancrer son projet dans un certain classicisme de pensée, il le fait en citant un auteur antique, Perse ; on n’oserait affirmer que cet auteur-là ait fait partie du bagage de tout intellectuel aux temps médiévaux.
C’est simple : c’est de la pure médisance, ça n’apporte rien, c’est du badinage invérifiable qui laisse entendre à demi-mot, mais sans le dire explicitement pour ne pas choquer plus qu’il ne faudrait : « vous voyez, quand même, au xviiie siècle, ils étaient plus cultivés qu’au Moyen Âge même si ils ne passaient pas leurs journées à recopier des manuscrits à la bougie ». Bref, c’est à la fois idiot, agaçant et inutile.
On pourrait continuer longtemps : chaque page apporte son lot de caricatures mesquines et sans humour ni finesse, de partialité fleurant la malhonnêteté intellectuelle la plus nauséabonde, de mauvaise poussée à un tel degré qu’on pourrait presque y voir un puissant exercice rhétorique. Comme dirait Odieux connard, « s’il est possible de faire de l’encre à partir de matières fécales, je peux vous assurer que ce livre a été écrit avec un stylo-plume ». Pour en finir avec le Moyen Âge est un ouvrage méprisant et moralisateur à l’égard des autres périodes que celle que Régine Pernoud adore religieusement, à l’égard aussi de la France, systématiquement descendue face aux autres pays qui, eux, font tellement mieux — elle ne cite d’ailleurs jamais d’exemple précis à ce propos.
Fait remarquable : Régine Pernoud qui professe tant d’admiration pour le Moyen Âge et sa littérature, préfère citer deux vers de Boileau (sur Villon) pour les critiquer, que des vers de Charles d’Orléans pour les faire aimer.
Si vous voulez aimer le Moyen Âge, écoutez Jaufré Rudel, Guillaume de Machaut ou Johannes Ockeghem, lisez Chrétien de Troyes et Charles d’Orléans, contemplez les portiques décorés et les dessins dans les manuscrits — n’en finissez pas — et ne perdez pas votre temps avec les propos hargneux et rageurs (et mal écrits) de Régine Pernoud Pour en finir avec le Moyen Âge.
INFORMATIONS
Seuil, 1977.
Post Scriptum. Il va de soi — mais c’est encore mieux en le disant — que le présent texte n’est en rien une attaque contre une éventuelle “réhabilitation” du Moyen Âge. Il n’a d’autre prétention que de pointer du doigt les erreurs manifestes, qu’elles soient de raisonnement, de généralisation, de faits, du livre. Pour une meilleure lecture, on se dirigera avec bonheur vers Le Moyen Âge : une imposture de Jacques Heers, Perrin, 1992, 2008, ouvrage rigoureux et passionnant qui propose une réflexion sur les notions mêmes de Moyen Âge et de Renaissance.
D’AUTRES ARTICLES