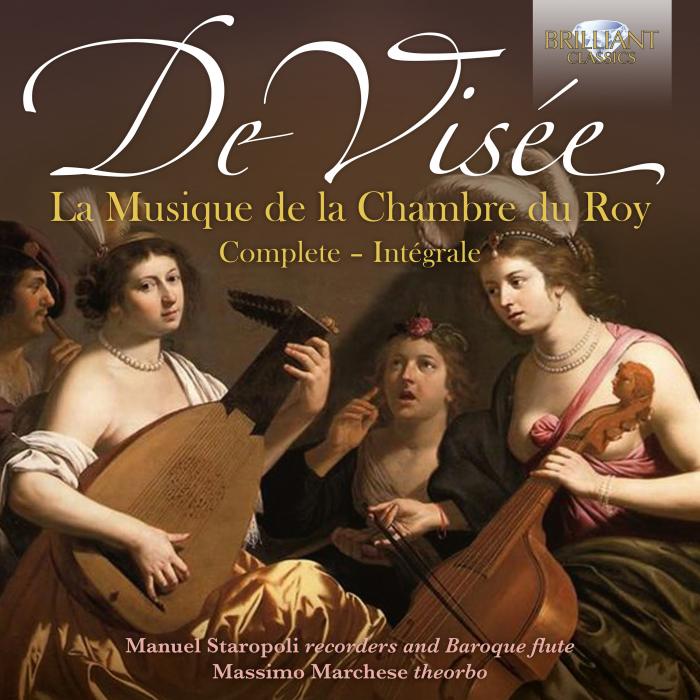par Loïc Chahine · publié jeudi 1 février 2018

C’est devenu notre petit rituel : chaque année, à la Folle Journée, nous allons écouter Jocelyne Cuiller au clavicorde. Comme l’an passé, nous en avons cette fois fait notre ouverture de festival. Dans son programme audacieux se côtoient Louis Couperin et les Bach, Froberger et Bartók, avec, pour commencer, deux tombeaux : celui de Ferdinand IV par Froberger, celui de Monsieur de Blancrocher par Louis Couperin. Bien que cet instrument de l’intimité eût pu y convenir à l’épanchement des douleurs face à la mort, Froberger ne « marche » pas très bien au clavicorde : il appelle l’ampleur du clavecin, car plus qu’épanchement, son œuvre est oraison. Avec Louis Couperin, déjà, les choses deviennent plus intéressantes, car les nuances que s’autorise Jocelyne Cuiller et que permet le clavicorde apportent une grande lisibilité au propos.
Cette même lisibilité sert à merveille le Capriccio sopra la lontananza del suo fratello diletissimo de Bach : le premier mouvement fait montre d’une très belle articulation, il parle véritablement ; dans le second, le thème, traité en quasi-fugue, est bien mis en valeur à chacun de ses retours sans pour autant renvoyer le reste de la musique à l’arrière plan — ce qui rend la pièce, une fois encore, très lisible ; on retrouvera cette qualité dans la fugue finale également. Les deux mouvements suivants ont quelque chose de quasi romantiques : le Lamento fait presque penser à Schubert, tant il s’élève hors du temps, et l’Adieu a des accents quasi schumanniens.
C’est par la pièce « Hommage à Bach » que s’ouvrent les extraits choisis par Jocelyne Cuiller de Mikrokosmos de Bartók. Les pièces retenues sonnent finalement assez bien au clavicorde — et font surtout entendre une musicienne d’une grande sensibilité. Cette même sensibilité gouverne la dernière pièce, l’Adieu à mon piano Silbermann de Carl Philipp Emanuel Bach, comme éperdu ; ici, Jocelyne Cuiller peut montrer comme elle possède son clavier et sait en faire vivre tout le potentiel expressif.
***
Après ces explorations, pour certaines inattendues sur un instruments qu’on n’entend que rarement, autre combinaison inattendue : Haydn au clavecin. Haydn au clavecin ? Pierre Gallon s’en explique longuement au début du concert : bien des œuvres que nous avons aujourd’hui l’habitude d’entendre au piano ont été destinées originellement au clavecin en premier lieu, car Haydn n’est pas Beethoven, il est né en 1732.
Le concert n’a pas été toujours de tout repos pour le claveciniste, mis devant un clavecin qui ne répondait pas toujours bien à ses sollicitations ; il aura fallu quelques bricolages en cours de programme, et l’on comprend bien la déstabilisation qui aura pu en résulter pour Pierre Gallon. Cela ne l’a pourtant pas empêché de délivrer un Haydn de haut vol, tant en expressivité qu’en virtuosité, un Haydn tout en élégance et en naturel. On aura même entendu, par moments, apparaître des sonorités totalement différentes et nouvelles de celles qui sortaient de l’instrument un moment auparavant — et il y avait là quelque chose de magique.
Il faut dire que Pierre Gallon évite la monotonie, habile qu’il est, par exemple, à mettre en valeur tel mouvement de basse dans le Menuet de la Partita Hob.XIV.6 sans pour autant perdre la mélodie ; il ne tombe pas non plus dans la facilité : l’Adagio qui suit ne s’embarque pas dès le départ sur le « petit jeu » du clavecin, pour « faire mouvement lent », d’une manière artificielle. Au contraire, rester sur le « grand jeu » permet de donner une espèce de noblesse dans l’adversité, tel exactement que Sacha Guitry décrivait le tragédien Mounet-Sully :
« Mounet-Sully entrait en scène comme si l’on venait, à l’instant même, de l’arracher au sommeil en lui annonçant que sa mère était morte et que son fils venait d’assassiner sa femme, et (…) il semblait supporter courageusement ces évènements1. »
Un instant après, voici le pimpant Finale qui, toutefois, a peut-être manqué un peu de respiration pour vraiment mettre en valeur certains traits d’esprits de Haydn, certains traits d’humour et/ou d’humeur.
D’humeur, le Geistlisches Lied n’en manque pas, et rappelle avec éclat que Haydn savait écrire de la musique émouvante — et mouvante, d’ailleurs. Pierre Gallon sait en restituer le caractère, et l’on croirait entendre l’esprit d’un Carl Philipp Emanuel Bach, mais concentré, condensé, canalisé dans la rigueur de la forme classique. Plus loin, le superbe Larghetto de la sonate Hob.XVI.24 s’épanche dans une esthétique de la déchirure, de la consolation et de la réminiscence.
Avec l’Allegro initial de la sonate Hob.XVI.24, c’est la virtuosité qui éclate : une agilité dactylique dans des traits qui rappellent Domenico Scarlatti, manuelle aussi dans la fluidité des changements de clavier. Cette virtuosité sera là, triomphante, dans le Capriccio Hob.XVII.1 qui terminera le programme où, on ne sait pourquoi, le clavecin restitue bien l’ancrage dans le sol, dans la terre, du Lied que Haydn s’est approprié pour le « varier », et prend des airs goguenards. Beau finale de concert, en effet !1. Sacha Guitry, Lucien Guitry raconté par son fils, Raoul Solar, 1953, p. 138. ↑
INFORMATIONS
Concerts donnés dans le cadre de La Folle Journée de Nantes, mercredi 31 janvier 2018.
D’AUTRES ARTICLES