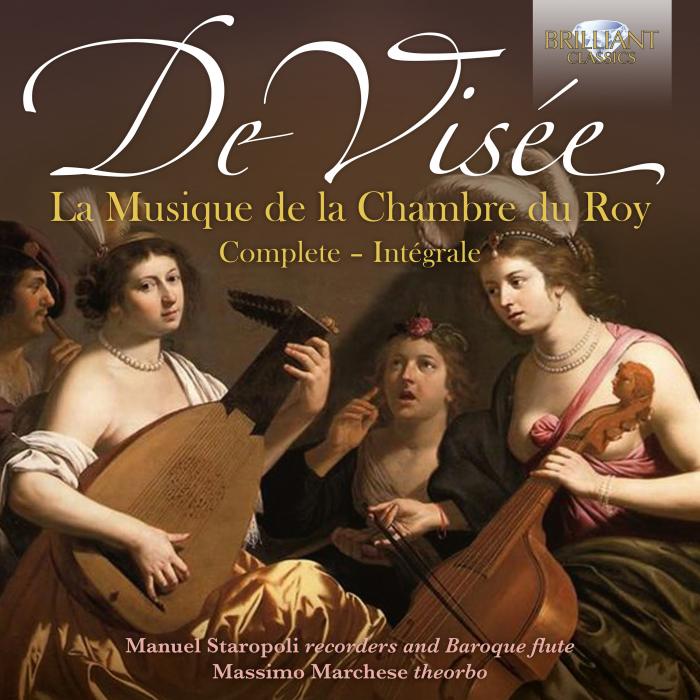par Loïc Chahine · publié samedi 8 octobre 2016

Depuis de nombreuses années, des recherches ont levé le voile sur tout un pan de théâtre du xviiie siècle, en particulier de la première moitié du siècle, appelé « théâtre de la Foire » ou « des Foires ». L’appellation, bien qu’elle soit d’époque1, peut tromper : les théâtres des Foires ne sont pas des tréteaux dressés au milieu d’un carrefour venteux, image encore souvent véhiculée2, mais bien de véritables théâtres « en dur », avec leurs loges, leur fosse et même de la machinerie, car ces Foires devaient davantage ressembler à des centres commerciaux qui n’auraient de bail que trois mois par an environ (et ce dans à deux reprises, dans deux lieux différents : foire Saint-Germain en hier et foire Saint-Laurent en été), qu’à un marché populaire. La noblesse allait à la Foire, Diderot allait à la Foire, et Buffon, Buffon même, avec ses fameuses manchettes de dentelles, allait à la Foire3.
Ces théâtres, toutefois, n’avaient pas, en général, d’existence officielle. Depuis les années 1670–1680, une politique rigoureuse a été mise en place par Louis XIV : un théâtre a besoin pour exercer d’un privilège qui lui assure un monopole, et les autres ferment. Si la création de l’Académie royale de musique (longue et douloureuse) ne pose pas énormément de problèmes de cet ordre puisqu’il n’y a pas véritablement de concurrence et que dès l’origine, l’idée est qu’il n’y en ait surtout pas, c’est seulement en 1680, par la réunion des deux seules troupes de théâtre parlé français qui restaient à Paris, celle du Guénégaud (elle-même réunissant la troupe des compagnons de feu Molière et la troupe du Marais) et celle de l’Hôtel du Bourgogne, que le projet se concrétise véritablement par la création d’un seul et unique théâtre parlé en langue française à Paris, la Comédie-Française.
Ainsi donc, quand des entrepreneurs et des troupes qui menaient leur vie davantage en province ont l’idée de profiter des foires pour montrer des pièces, ils sont hors-la-loi. Ce n’est pas bien grave… sauf quand ils finissent par avoir du succès et que cela porte ombrage à la Comédie-Française qui fait valoir son privilège et intente procès sur procès aux « forains », les juges leur interdisant alors ce qui semble le plus juste à leurs yeux, c’est-à-dire en général non pas purement et simplement de faire du théâtre mais de faire du théâtre « comme la Comédie-Française » : interdiction du dialogue, interdiction du français… L’idée viendra de chanter, qui tombera sous le coup du privilège de l’Académie royale de musique : interdiction du chanté… Mais pas tout le temps ! Car l’Opéra a besoin de beaucoup d’argent et donc propose de monnayer, fort cher d’ailleurs, le droit à du chanté, des musiciens, des danseurs et des changements de décors. Il y aura aussi interdiction des acteurs, d’où le recours aux marionnettes. Car à chaque interdiction son recours : pas de dialogue ? on fera des monologues. Pas de chanté ? on fera chanter le public sur des airs connus (appelés vaudevilles) en lui montrant les paroles à chanter sur des écriteaux. (En plus des centre commerciaux, le xviiie siècle a donc inventé le karaoké : on ne sait laquelle de ces deux inventions est le plus à blâmer.)
C’est en quelque sorte cette histoire que La Guerre des Théâtres se propose de raconter, prenant prétexte d’une représentation d’une pièce de Louis Fuzelier, inspirée de Pétrone via La Fontaine, La Matrone d’Éphèse, représentation interrompue par les opposants (la Comédie-Française et l’Opéra, donc) et qui doit se poursuivre malgré les interdictions.

Il en résulte un spectacle agréable, mais pas totalement cohérent et par là un peu frustrant sur certains aspects. Tout d’abord, prenant acte que les spectacles forains ne sont pas « cheap », la scénographie est à la hauteur des exigences, avec en premier lieu un décor somptueux, venu tout droit du Petit Théâtre de Marie-Antoinette, à Versailles, aimablement prêté par le Château, et qui est un ravissement pour l’œil. Les costumes sont chatoyants, voire éblouissants ou carrément somptueux (l’Opéra), et il est réjouissant de pouvoir apprécier la partie visuelle d’un spectacle avec un peu de naïf émerveillement. Ajoutons que les éclairages de François-Xavier Guinnepain sont aussi soignés qu’élégants : l’œil est véritablement à la fête.
Le jeu d’acteur mérite aussi, dans l’ensemble, d’être loué, en particulier du côté des chanteurs et chanteuses. Ainsi, Sandrina Buendia, excellente soprano d’ailleurs, incarne Colombine et l’Opéra avec un grand sens de l’à-propos ; il en va de même de Jean-François Lombard en Matrone, qui trouve toujours ce qu’il faut de premier et de second degré ; tous deux parviennent à un équilibre entre convention théâtrale (« je joue sur une scène ») et un certain naturel (« je n’en fais pas des kilomètres, je ne me regarde pas jouer excessivement »). Le cas d’Arnaud Marzorati est un peu plus compliqué : le rôle de Pierrot n’est sans doute pas taillé pour lui, en tout cas pas ce Pierrot-là, ce Pierrot idiot : on ne sait que trop qu’Arnaud Marzorati est intelligent, et, en fait, on le sent un peu. Bien sûr, son Pierrot idiot est parfaitement maîtrisé, mais justement, peut-être trop ; aussi l’avons-nous préféré en exempt (envoyé de la Comédie-Française) parfaitement délirant et débridé : là, il a livré l’un des grands moments du spectacle. Chez aucun le chant n’est à reprocher.
Quant aux deux acteurs (qui ne sont pas au départ des chanteurs), leur cas est un peu particulier. Jean-Philippe Desrousseaux a le rôle de la Comédie-Française, incarnée en fait par un Comédien Français. Il en a fait un personnage bouffi d’orgueil, réjoui de lui-même et terriblement hargneux envers les autres, assez détestable mais hautement réussi dans son genre, parce que haut en couleurs et justement parodique. Ajoutons que quand il prend la marionnette de Polichinelle, il se révèle assez différent, et signe un des autres moments les plus réussis du spectacle (faisant aussi, et avec brio, la voix d’un vieux Comédien Français essoufflé, tandis que la marionnette est tenue par Bruno Coulon). On demeure un peu sceptique quant à l’Arlequin de Bruno Coulon, dont le jeu ne nous a pas paru en totale adéquation avec celui de ses partenaires, peut-être parce que trop personnel. Dès lors, ses monologues sont plus réussis que les scènes où il dialogue avec les autres.

La musique est honorablement jouée, mais il aurait fallu un ensemble un peu plus conséquent et plus « traditionnel » pour réellement faire s’envoler la partie musicale. Ne serait-ce que deux violons, et idéalement un hautbois, auraient donné à tout cela de l’ampleur ; ici, sans doute à cause de la petitesse de l’ensemble, la musique semble souvent passer au rang de simple accompagnement, ce qui est bien dommage, car on perçoit, quand on peut, des subtilités dans les choix musicaux, les phrasés, les arrangements.
En revanche, l’ensemble de la pièce manque de rythme dramatique, et ce pour plusieurs raisons. La première, c’est qu’à chaque interdiction, les acteurs reprennent le même schéma, « qu’allons-nous trouver maintenant ? », et y passent un certain temps… Bon, soyons honnêtes, on sait qu’ils vont trouver et ils ne font jamais d’autres proposition que la bonne (ce qui ne rend pas la petite recherche très crédible), alors une certaine lourdeur s’installe là. D’autre part, la pièce de Fuzelier, La Matrone d’Éphèse, qui est censée être représentée, a ici été sabordée puisqu’il n’en reste pas 20 %. Certes, ce spectacle n’est pas La Matrone d’Éphèse de Fuzelier, mais tant qu’à avoir une pièce-support, autant pouvoir la respecter, or, les motivations des personnages dans ce qui reste de la Matrone demeurent peu claires, et finalement, on a l’impression qu’on joue une pièce parce que bon, il faut bien jouer une pièce. Certaines des meilleures « blagues » sont conservées, mais sorties de leur contexte dramatique (et La Matrone est de plus une pièce en trois actes, d’une grande richesse), on a l’impression que ce n’est qu’une espèce d’enfilade. Mieux eut valu se tourner vers une pièce plus modeste. Ici, il n’y a plus vraiment d’intrigue de la pièce, les amoureux ayant été purement et simplement supprimés, les étapes de l’exposition et de la résolution étant assez gauchement gérées.
Enfin, et c’est plus grave, les séquences d’interdictions, à part la toute première (les monologues) ne reprennent pas la pièce à jouer. En effet, quand des écriteaux sont présentés au public, ce n’est qu’une espèce de gentille chanson à boire. Mais ! les pièces par écriteaux, c’étaient des pièces, et les acteurs jouaient leur partie en pantomime en-dessous. On aurait souhaité voir ce que cela pût donner, et cela aurait donné un peu de corps aux Débris de la Matrone (Fuzelier lui-même appelle Les Débris des Saturnales une pièce qu’il a faite en réduisant sa propre parodie Les Saturnales, en 1723) ; de même la séquence aux marionnettes, si excellente soit-elle, n’est qu’un excursus qui, à nouveau, sort de la pièce qu’on se propose de jouer.
De plus, lesdites interdictions ne prennent pas tout leur sens. En effet, « on n’a plus le droit de parler alors on chante », certes, mais en fait, « on chantait » dès le début ! Pendant les monologues, on a presque encore des dialogues, de sorte que tout cela demeure peu clair.
En somme, voilà un spectacle plus agréable que toujours clair, mené avec enthousiasme et professionnalisme, rempli d’idées, et qui a de quoi plaire au public. (Et après tout, le public se paie-t-il de clarté ? Fuzelier ne notait-il pas qu’on ne pouvait pas faire d’opéras raisonnables ? — alors, des opéras-comiques ?). Mais nous souhaiterions que les théâtres « forains » sortent du répertoire pédagogique. Car raconter ces interdictions faisait déjà l’objet d’une partie du spectacle Commedia Comédie de Chantal David et sa compagnie Bel Viaggio, par exemple. Plus récemment, Les Funérailles de la Foire, d’après la pièce de Fuzelier, Le Sage et d’Orneval, créées par Judith le Blanc et Pêcheurs de Perles, se faisait aussi l’écho de ses vives querelles entre les théâtres. Et si l’on veut remonter encore plus loin, en 1736, Le Sage lui-même raconte ces aventures dans L’Histoire de l’Opéra-Comique ou les Métamorphoses de la Foire, opéra-comique en quatre actes et un prologue de « imaginé […] pour donner une idée des différents changements que l’Opéra-Comique avait souffert depuis son établissement » et mettant à la suite des pièces illustrant chaque interdiction. Le répertoire forain ne se limite pas à ces pièces, et l’on se demande quand une structure, avec à sa disposition les moyens nécessaires, aura la véritable audace : celle de monter un opéra-comique avec des vaudevilles « tout pur », sans aménagement. Car faire vivre le théâtre de la foire, ce n’est pas seulement narrer l’histoire du théâtre de la foire : c’est remettre à jour son répertoire. Ce n’est pas ce répertoire qui manque !
1. Voir par exemple le titre du recueil de pièces compilé par Le Sage et d’Orneval, Le Théâtre de la Foire ou l’Opéra Comique, 10 volumes, 1721–1737. ↑
2. C’était par exemple le cas dans le documentaire sur Rameau diffusé sur Arte à l’occasion du tricentenaire de la mort du compositeur, dont ce n’était pas au demeurant la seule inexactitude. ↑
3. Pour Buffon à la foire, voir Maëlle Levacher, Buffon et ses lecteurs, Classiques Garnier. Pour Diderot, plusieurs points, qu’il serait trop long à développer hier, tendent à prouver qu’il fréquentait la Foire et qu’il avait une bonne connaissance du vaudeville, comme la scène de l’opéra dans Les Bijoux indiscrets. Enfin, concernant les études sur les théâtres forains, on se reportera en particulier aux travaux récents et éditions de Françoise Rubellin (en particulier Théâtre de la Foire : Anthologie de pièces inédites, Espaces 34, mais aussi de nombreux articles), Anastasia Sakhnovskaïa («La Naissance des théâtres de la Foire : influence des Italiens et constitution d’un répertoire», thèse de doctorat, Université de Nantes, 2013.). D’autres études s’attachent au genre de la parodie dramatique, particulièrement illustré à la foire, comme celle de Pauline Beaucé, Parodie d’opéra au siècle des Lumières : Évolutions d’un genre comique, Presses universitaires de Rennes, 2013. Enfin, en ce qui concerne la figure de Fuzelier, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse « Louis Fuzelier, le théâtre et la pratique du vaudeville : établissement et jalons d’analyse d’un corpus » (Université de Nantes, 2014). ↑
INFORMATIONS
La Guerre des Théâtres
Jean-Philippe Desrousseaux, mise en scène
Arnaud Marzorati, direction artistique
François-Xavier Guinnepain, lumière
Françoise Rubellin, conseillère théâtrale
Sandrine Buendia, Colombine, L’Opéra
Bruno Coulon, Arlequin
Jean-Philippe Desrousseaux, La Comédie-Française, Polichinelle
Jean-François Lombard, La Matrone d’Éphèse
Arnaud Marzorati, Pierrot, Un Exempt
La Clique des Lunaisiens
Mélanie Flahaut, flûte, basson
Isabelle Saint-Yves, viole de gambe, dessus de viole
Massimo Moscardo, luth
Blandine Rannou, clavecin
Décor historique du Théâtre de la Reine — Château de Versailles.
Costumes du Centre de musique baroque de Versailles et de l’atelier de costumes d’Angers Nantes Opéra.
Marionnettes créées par Petr Řezač et Katia Řezacová.
Photos © Jef Rabillon /Angers Nantes Opéra
D’AUTRES ARTICLES