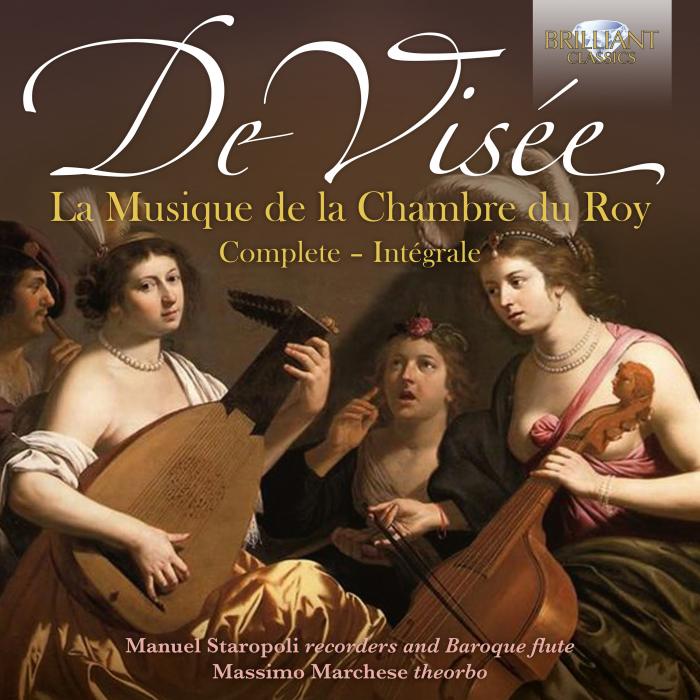par Loïc Chahine · publié samedi 7 mars 2015 · ¶¶¶¶

Il fallait bien qu’à un moment ou un autre, la collection discographique du label Hortus consacrée à la musique en lien avec la première guerre mondiale se penche sur la figure du pianiste Paul Wittgenstein, qui perdit son bras droit dans le conflit.
Son histoire, c’est d’abord celle du fils d’un industriel, Karl, qui avait lui-même connu une jeunesse houleuse : né lui-même d’un père entrepreneur et d’une mère issue d’une grande famille viennoise, le jeune Karl, sixième des onze enfants, s’enfuit à dix-huit ans de la maison familiale pour aller chercher fortune aux États-Unis… avec son violon. Il joue et sert dans les bars américains, et revient deux ans plus tard, en 1867, entamant alors des études à l’université technique de Vienne. Embauché dans une usine, il en devient en quelques années le dirigeant et l’actionnaire principal, et fait fortune dans l’acier. Cette fortune lui permet d’assurer à ses enfants une éducation privilégiée, et les deux derniers auront tous deux un destin remarquable pour l’histoire culturelle : Paul sera pianiste, Ludwig philosophe. La fortune familiale faisant de la famille Wittgenstein une des maisons en vue de l’Autriche, quelques célébrités y viennent, et le jeune Paul aura l’occasion de rencontrer Johannes Brahms, Gustav Mahler ou Richard Strauss, parfois même de jouer avec eux.
Ses débuts de pianiste sont cependant mis à mal par le début de la guerre ; comme bien d’autres, il est appelé au front. Il est blessé et fait prisonnier ; il faudra l’amputer du bras droit. Mais sa force de caractère est telle qu’il décide de continuer sa carrière, de jouer de la main gauche seulement. Et la fortune acquise par ses aïeux aidant, il commande plusieurs pièces concertantes : Ravel, bien sûr, qui lui écrira le Concerto pour la main gauche en ré majeur bien connu, et Prokofiev, mais aussi Richard Strauss (Panathenäenzug: Sinfonische Etüden in Form einer Passacaglia, op. 74), Paul Hindemith (Klaviermusik mit Orchester, op. 29) et Benjamin Britten (Diversions), pour ne citer que quelques noms. Au total, plus d’une douzaine de pièces… qui occasionnèrent souvent des déboires. Ainsi, Ravel et Wittgenstein se disputèrent à propos du Concerto… avant que le pianiste ne reconnaisse qu’une fois la partition étudiée à fond, il en avait reconnu la grandeur — anecdote qui n’est pas sans rappeler celle de Paganini, Berlioz et Harold en Italie… Quant au concerto commandé à Prolofiev, le Concerto no 4, op. 53, Wittgenstein ne le joua même pas, non plus que la Klaviermusik de Hindemith.
Au moment où le parti nazi prend le pouvoir, Paul Wittgenstein est inquiété, car sa famille, bien que convertie au protestantisme depuis la fin des années 1830, était d’origine juive ; le pianiste quitte donc l’autriche en 1938. Il s’installera à New York, et c’est là qu’il rencontrera Benjamin Britten à qui il commandera une œuvre en 1940. Il faut croire que les rapports, une fois de plus, ne furent pas de tout repos, car Britten se plaignit à sa sœur et lui écrivit entre autre qu’il faisait le concerto — qui serait en fait une série de “variations”, si l’on peut encore les appeler ainsi — surtout parce que Wittgenstein payait.
Il convient de signaler que Wittgenstein ne fut pas le seul à jouer et à motiver des œuvres pour la seule main gauche au piano et l’orchestre : le tchèque Otokar Hollmann, qui en fait avait commencé sa carrière comme violoniste, fut, comme Wittgenstein, blessé pendant la guerre et perdit son bras droit ; il apprit alors le piano et commanda des œuvres entre autres à Janáček et Martinů.
Pour revenir à Wittgenstein, il payait au demeurant suffisamment bien pour que s’arroger les droits d’exclusivité des œuvres pour au moins un certain temps, de sorte que les œuvres qu’il avait achetées et qu’il n’aimaient pas suffisamment n’étaient plus jouées ni par lui, ni par personne d’autre. C’est ce qui advint des Diversions de Britten. Sans doute le jugeait-il trop peu brillant. Le piano y est traité, la plupart du temps, comme un instrument de l’orchestre — certes instrument de premier plan, mais avec peu de virtuosité — et l’écriture pour une seule main est souvent traitée de manière linéaire — tandis que d’autres compositeurs donnent davantage l’illusion des deux mains.
Même si les mouvements s’appellent “variations”, suivi d’un chiffre et d’un autre titre, il ne s’agit pas de variations au sens traditionnel du terme. Britten livre en fait une série de pièces assez brèves, parfois enchaînées, toujours caractérisées, et dont le titre de Diversions semble parfaitement rendre compte tant chacune semble se détourner de celle qui la précède. Les lignes sont claires et l’inspiration ne se tarit guère. On y remarquera des moments particulièrement réussis, comme la diabolique « Marche » (var. 3) qui n’est pas sans rappeler quelques pages de Chostakovitch — les deux hommes s’estimaient beaucoup — ou l’élégiaque et beau « Nocturne » (var. 6), l’idyllique « Arabesque » (var. 4), qui feront davantage penser, peut-être, à Saint-Saëns. On s’étonne, finalement, qu’une œuvre aussi aimable — Britten jugeait ces Diversions « pas profondes — mais fort jolies ! » — et sans doute même un peu plus que jolies, tout de même ! écoutez l’Adagio — n’aient pas davantage retenu l’attention des orchestres, à défaut des solistes, tant elles offrent de finesses et de climats variés, comme un équilibre subtil entre les illustrations d’une même série.
Avec Korngold, l’ambiance est bien différente. Le compositeur alla lui aussi s’installer aux États-Unis en 1936, et plus particulièrement à Hollywood, où il écrivit de nombreuses musiques de films pour la firme Warner Bros. Mais son Concerto pour piano en ut dièse est bien antérieur : il date de 1922 et se trouve être l’une des premières œuvres commandées par Wittgenstein — les premières composées pour lui suite à sa mutilation étant dues à son ancien professeur Josef Labor. On perçoit cependant dans ce Concerto bien des traits qui, aujourd’hui que le langage musical post-romantique fait partie intégrante de l’écriture musicale de bandes originales, évoqueront le cinéma, comme un puissant élan dramatique, quasi narratif — l’œuvre est d’ailleurs d’un seul tenant, sans nette séparation de mouvements (durchkomponiert) —, ou un ardent lyrisme ; plus concrètement, la partie de piano est ici nettement plus virtuose, tout comme l’orchestration qui s’avère grandiose. Les Diversions de Britten s’épanouissent dans la retenue, le Concerto de Korngold est nettement plus expansif ; les couleurs du premier sont oniriques, quand celles du second sont vives ; Britten se peint comme un rêveur romanesque et poétique, Korngold comme un jeune homme aussi pétulant que talentueux.
La lecture des deux œuvres par Nicolas Stavy, l’Orchestre national de Lille et le chef Paul Polivnick est séduisante, les interprètes se trouvant aussi à l’aise chez Britten que chez Korngold. La tâche qui échoit à Nicolas Stavy n’est guère aisée : il s’agit tantôt de s’intégrer parfaitement à l’orchestre, tantôt de transcender l’écriture à une main pour donner la plénitude d’une musique pour piano “traditionnelle”. De ces missions, le pianiste se tire avec brio, ne laissant guère transparaître la difficulté et faisant sonner aussi bien Britten que Korngold avec naturel ; avant d’écouter des concertos “pour la main gauche”, on écoute des concertos pour piano. La cohésion avec l’orchestre est admirable chez l’Anglais, dont les mouvements lents sont enchanteurs, mais la maestria et la force de l’Autrichien ne semble pas moins lui convenir. À ces côtés, l’Orchestre national de Lille, dirigé par Paul Polivnick, est un partenaire de premier choix en terme de couleurs (celles réclamées par Britten, par leur finesse, laissant souvent un pupitre à découvert, sont fragiles, et s’avèrent ici une grande réussite) comme d’engagement (primordial pour le Korngold). L’équilibre entre les forces en présence semble à tout moment idéal, même si je soupçonne la prise de son de mettre le piano en avant.
Pour peu qu’on prenne le soin de se familiariser avec les deux idiomes musicaux, assez différents (Britten semblant aller vers une forme d’épure et de concentration, Korngold vers un expressionnisme avide de grands espaces), des deux œuvres, et les apprécier pour ce qu’ils sont, ce dixième volume des « Musiciens de la Grande Guerre » proposé par les éditions Hortus deviendra un agréable compagnon qui rappellera — c’est toujours opportun — que les affres de la barbarie belliqueuse peuvent parfois être dépassés par l’art, et pas seulement en faisant un art engagé, mais en faisant de l’art tout court.
INFORMATIONS
Britten : Diversions pour piano main gauche et orchestre
Korngold : Concerto pour piano main gauche en ut dièse
Nicolas Stavy, piano
Orchestre national de Lille
Paul Polivnick, dir.
Hortus, « Les Musiciens de la Grande Guerre », vol. 10, 2015.
D’AUTRES ARTICLES