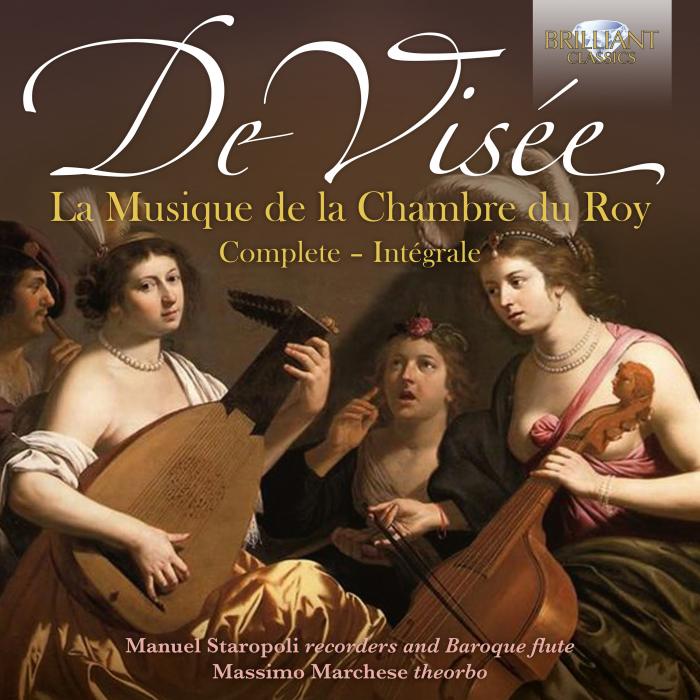par Loïc Chahine · publié vendredi 15 avril 2016

En 2005 était représentée la production du Bourgeois gentilhomme mis en scène par Benjamin Lazar. Par son succès éclatant, ses nombreuses reprises et sa publication en dvd, parce qu’elle reprenait un certain nombre de préceptes que l’on trouve dans des traités du xviie siècle, elle a donné l’impression d’être l’équivalent du travail des « baroqueux » en musique, d’être très parfaitement conforme aux sources et de réaliser le vœux de Philippe Beaussant à la fin de Vous avez dit baroque ? : voir la représentation théâtrale entrer, elle aussi, dans l’historiquement informé. C’était oublier qu’il s’agissait aussi, voire surtout, d’une vision artistique personnelle, et qu’à l’application de quelques préceptes tirés de traités se mêlaient l’enseignement reçu, des convictions personnelles et des partis pris artistiques. En somme, on a souvent oublié que c’était un spectacle, et non la projection de résultats d’une recherche scientifique poussée.
Cela ne serait pas un problème si ce type de spectacles demeurait une proposition parmi d’autres et n’était pas devenu une norme, un label. Car il y a aujourd’hui un label « théâtre baroque », « déclamation baroque » qui reflète la standardisation de l’« historiquement informé » (ou prétendu tel) et témoigne bien de la tentation de former un modèle répertorié par les producteurs de spectacles et reconnaissable par le public, modèle qui n’est pas réellement historiquement informée mais tient davantage de la vision. Si l’on voulait comparer avec la musique, ce serait comme si on en était resté aux premières tentatives de pionniers comme Leonhardt, Harnoncourt ou Brüggen, dans les années 1950 — et l’on sait le chemin parcouru, du point de vue de la maîtrise technique comme de la recherche, de là aux années ne serait-ce que 1970, y compris par les maîtres que nous venons de citer — en ajoutant par dessus quelques visions esthétiques du genre de celles de L’Arpeggiata. Bref : du fantasme mâtiné de quelques relents d’historicité, mais pas de l’historiquement informé. Bien sûr, les artistes ont généralement soin de préciser qu’il ne s’agit pas de reconstitutions, mais les producteurs de spectacles et a fortiori les spectateurs ne sont pas si scrupuleux, et on voit vite fleurir l’idée que c’est là du « théâtre baroque », avec le sous-entendu que « c’était comme ça à l’époque » — et il y a jusqu’à une espèce d’atelier « théâtre baroque » pour des collégiens, en marge de l’Académie Bach d’Arques-la-Bataille, qui apprend de graves fautes voire des inepties à de jeunes gens qui ne peuvent les relativiser ou les remettre en question1.

Le but du programme de recherche expérimentale « Jouer L’École des femmes de Molière selon les sources historiques » n’est pas de créer un spectacle fini et satisfaisant pour le public d’aujourd’hui, mais d’appliquer autant que possible tout ce que l’on sait ou ce que l’on peut déduire ou tenter de déduire des sources, des traités, des témoignages, de l’iconographie, etc. Il a été l’occasion de plusieurs journées d’étude dont les résultats devraient être publiés dans la revue en ligne Arrêt sur scène cet automne, et débouche également sur quelques représentations d’un travail toujours en progrès mais déjà très parlant. Il ne s’agit nullement, précisons-le encore, pour ces chercheurs, de dénigrer le travail de pionniers comme Dene Barnett, Philippe Lenaël ou Eugène Green2, mais plutôt de chercher à le préciser et à le dépasser non plus par un travail artistique, esthétique, mais bien par une recherche historique plus approfondie, plus poussée, plus précise.
Nous avons assisté à une représentation de cette École des femmes historiquement informée le 8 avril 2016 ainsi qu’à la journée d’étude du lendemain qui abordait quelques-uns des problèmes liés à cette réalisation. Comme il convient de rendre compte de l’un et de l’autre, nous proposerons deux articles. Celui-ci est consacré au spectacle du 8 avril ; un suivant donnera ensuite quelques éléments de nature plus scientifique sur sa réalisation dont nous avons eu connaissance lors de la journée d’étude du lendemain.
Disons-le d’emblée, il s’agit assurément d’un jalon majeur pour la connaissance de ce que pouvait être une représentation d’une pièce de Molière par la troupe de Molière. Hâtons-nous d’ajouter que quoique mené non par des professionnels de la scène mais par des chercheurs, la représentation que nous avons vue était d’un haut niveau et n’avait pas grand-chose à envier à des productions professionnelles.
Loin de ces représentations de comédies d’une austérité telle que l’on se croirait au sermon, ici, le public riait — et pas qu’un peu. Ce spectacle restituait tout le potentiel comique de L’École des femmes, qui n’est pourtant la pièce de Molière la plus bouffonne. Car « spectacle historiquement informé » ne veut pas dire produit à moitié décongelé et, osons le mot (si vulgaire soit-il), emmerdant. Ce n’est pas parce qu’un tableau date du xviie siècle que vous vous ennuyez en le regardant ; eh bien ici c’était pareil. Il n’y a donc pas à craindre d’être ennuyeux en étant historique.
Le parti pris de départ, exposé en préambule de la représentation par Mickaël Bouffard, est clair : ne négliger aucune source, ne jamais se dire « ça va être moche », « ça va être bizarre » : si les sources nous disent que c’était, on le fait, sans porter de jugement esthétique ; ne pas se dire qu’on le fait « pour le public d’aujourd’hui » (en le prenant d’ailleurs — et c’est nous qui parlons ici, et non M. Bouffard — pour un idiot qui n’est pas capable faire la part des choses entre du théâtre ancien et sa propre perception, qui aurait besoin qu’on lui pré-mâche le travail de compréhension et d’appréciation) ; faire œuvre avant tout, et autant que possible, d’exactitude historique, car il s’agit bien d’un travail de recherche (fût-elle appliquée), d’archéologie (fût-elle expérimentale). Et ce n’est pas la moindre surprise que, sans compromis, ça fonctionne, et très bien par-dessus le marché. De même que l’on comprend bien quand on regarde un tableau de Jérôme Bosch qu’il ne date pas d’hier matin, on accepte que ces personnages que Molière a créés ne soient pas nos contemporains, et cela n’empêche pas leurs histoires et leurs propos d’avoir des résonances dans notre monde d’aujourd’hui ; au contraire : on laisse au xviie siècle ce qui lui appartient en propre et on retient ce qui est encore vrai.

Il faut dire que la compagnie du Théâtre à la Source remporte l’adhésion du public par un engagement constant, une vitalité et une justesse de jeu sans faille. À l’évidence, ici, chacun comprend ce qu’il raconte dans les moindres détails — et pour cause : ces acteurs sont des chercheurs. Que les discours (et ils sont nombreux dans cette pièce faite toute de récits) sont clairs ! Le jeu est vif, sans lenteur, cela avance « sans barguigner », et chaque personnage est nettement caractérisé. Signalons en premier lieu l’Arnolphe exceptionnel de Pierre-Alain Clerc, puissant et hilarant, excessif, ridicule, ne tenant pas en place, bref : ardemment moliéresque. Face à lui, Aurélia Pouch offre une Agnès qui d’abord paraît bête (comme il convient) mais s’avère finalement extrêmement touchante. Le Chrysalde d’Olivier Bettens est le parfait raisonneur : juste, accommodant et modéré, peut-être un peu en retrait. Frédéric Sprogis campe un Horace idéal, enthousiaste, un peu illuminé, l’air évaporé — sa grande taille semble d’ailleurs lui conférer un air encore peu plus tête en l’air. Marine Frileux propose une Georgette qui pourrait gagner un peu en personnalité et en gouaille, d’autant qu’elle est à côté de l’Alain rabelaisien de Luc Davin qui a beaucoup fait rire. Marc Douguet est excellent en notaire, quoique pas toujours compréhensible, mais demeure très effacé en Enrique, et Bénédicte Louvat-Molozay manque peut-être un peu de stature — mais peut-on l’en blâmer ? — pour convaincre totalement en Oronte, rôle au demeurant mineur. Il faut louer la direction artistique du projet, menée conjointement par Pierre-Alain Clerc pour la partie rhétorique et discours, et Mickaël Bouffard pour ce qui concerne le visuel (positions, postures, déplacement, bienséances, jeux de scène, costumes), tout en respectant scrupuleusement les indications historiques, d’avoir su faire véritablement du théâtre et non se contenter d’offrir une pièce de musée. L’expression de théâtre vivant n’est point usurpée.

Si l’oreille et l’esprit sont à la fête, l’œil y est aussi. Certes, la production se joue sans décor, pour des raisons de budget mais aussi d’organisation (les décors posent des problèmes de stockage et de transport), mais les costumes sont si beaux qu’on se passe aisément de toile de fond. Là aussi, un travail poussé (dont nous rendrons plus amplement compte dans notre second article) a été mené pour retrouver non seulement ce à quoi pouvaient ou auraient pu ressembler les costumes du point de vue de leur forme, mais aussi des matières utilisées, matières naturelles. Le résultat : c’est un enchantement à voir, et il faut en remercier Mickaël Bouffard, Delphine Desnus et toute leur équipe d’avoir donné sans compter leur temps pour la recherche comme pour la réalisation. Voilà qui fait ressentir vivement que le théâtre a aussi le droit d’être visuellement, esthétiquement, plastiquement séduisant et qu’il n’a pas à se cantonner ni dans le vestiaire contemporain, ni dans la quasi-obscurité qui connaît une certaine vogue dans la mise en scène.
Du point de vue des éclairages, on regrettera certes que la troupe du Théâtre à la Source n’ait pu bénéficier de moyens plus professionnels, réduite en arrivant au théâtre à bricoler l’équivalent d’une rampe avec les moyens du bord, qui éclairent par moment les acteurs et leurs costumes de manière excessive. Il est certain qu’on n’a pas nécessairement besoin aujourd’hui d’éclairer à la bougie et qu’il est tout à fait possible de produire un éclairage en tout point identique avec l’électricité, assurant des condition de sécurité meilleures, et ce sera sans doute là une recherche à poursuivre pour ce projet expérimental.

Enfin, autre spécificité de ce spectacle : la musique. Il n’y a pas que dans les comédies-ballets qu’il y en avait, et à peu près toute troupe de théâtre (à Paris au moins) se dotait, pour jouer dans les entractes, de musiciens pour jouer pendant les entractes. Dans le cas de L’École des femmes, il s’agissait d’une bande de quatre « violons » (c’est-à-dire d’instruments de la famille des violons) : dessus, haute-contre, taille et basse de violon. On y jouait tout simplement des pièces à la mode. Matthieu Franchin s’est chargé de chercher le répertoire, Gérard Geay a composé les parties intermédiaires manquantes dans certains cas, et les partitions ont été confiées à des étudiants du Département de musique ancienne du CRR de Paris et du Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt ; le CMBV a par ailleurs prêté les instruments dits « Vingt-Quatre Violons du Roy ». Toutefois, ces instruments, soi-disant reconstitués il y a quelques années, l’ont été selon des méthodes scientifiques plus que discutables, ayant déclenché d’ailleurs quelque polémique, et répondant mal aux exigences d’exactitude historique du Théâtre à la Source3. On ne peut que regretter que ces instruments n’aient pas été assortis des archets qui leur conviendraient et que les musiciens en aient été réduits à se contenter de leurs archets de modèle, semble-t-il, plutôt italien et probablement un peu plus tardif, et ne pouvant dès lors pratiquer la tenue d’archet à la française (avec le pouce non sous la baguette, comme dans la tenue à l’italienne, mais sous la hausse4), qui a une grande influence sur la manière de jouer. Les musiciens en présence n’ont donc pas pu faire montre d’une bonne maîtrise des pièces, qui sont des danses, et nous a paru jouer dans un style plutôt italianisant assez hors de propos ici. Bref, les entractes n’étaient pas parfaitement réussis pour cette fois. Voilà qui rappelle qu’en musique aussi, l’historiquement informé peut progresser en rigueur et en précision, et ce dès la formation des musiciens.
Toutefois, ces quelques imperfections d’éclairage et de musique, qui, nous n’en doutons pas, seront corrigées au fil de temps, ne sauraient gâcher notre plaisir. Cette École des femmes est un plaisir rare : celui d’un spectacle qui est aussi satisfaisant du point de vue de l’exactitude historique, de la démarche préparant l’information historique, que du résultat qui nous est donné à voir et à entendre. Il est à souhaiter qu’il puisse continuer de se bonifier et qu’il ait l’occasion d’être vu par d’autres spectateurs. Ainsi jouée, L’École des femmes est, allons jusque-là, un bonheur. Longue vie au Théâtre à la Source !
1. La vidéo dont nous avons ici donné le lien pourrait donner matière à elle seule à un article. Le simple fait d’appliquer la « diction haute » (celle de la tragédie et du sermon) à Molière et La Fontaine est déjà une erreur. ↑
2. Qu’il nous soit permis de préciser qu’il ne s’agit ici nullement de juger de la valeur artistique ou esthétique des travaux d’Eugène Green ou de Benjamin Lazar, mais de leur exactitude historique. ↑
3. Voir Karel Moens, « Les voix médianes dans l'orchestre français sous le règne de Louis XIV : les instruments conservés comme source d'information", dans L’orchestre à cordes sous Louis XIV. Instruments, répertoires, singularités, Jean Duron et Florence Gétreau (éd.), Paris, Vrin, 2015, p. 119-138. ↑
4. Cette tenue d’archet est encore décrite par Montéclair dans sa Méthode facile pour apprendre à jouer du violon, 1711–1712, et par Corrette (qui décrit aussi la tenue à l’italienne) dans L’École d’Orphée, Méthode pour apprendre facilement à jouer du violon, 1738. Voir aussi Nelly Poidevin, « L'archet dans l'orchestre français sous le règne de Louis XIV : morphologie, tenue, articulation », dans L’orchestre à cordes sous Louis XIV…, p. 105-118. ↑
INFORMATIONS
L’École des femmes de Molière, jouée selon les sources historiques.
Représentation du 8 avril 2016 au Forum Universitaire de l'Ouest Parisien.
Compagnie du Théâtre à la Source
Direction scientifique : Pierre-Alain Clerc, Bénédicte Louvat-Molozay, Mickaël Bouffard, Jean-Noël Laurenti.
Olivier Bettens (Chrysalde), Pierre-Alain Clerc (Arnolphe), Luc Davin (Alain), Marine Frileux (Georgette), Aurélia Pouch (Agnès), Frédéric Sprogis (Horace), Marc Douguet (le Notaire et Enrique), Bénédicte Louvat-Molozay (Oronte).
Costumes et accessoires : Mickaël Bouffard et Delphine Desnus.
Perruques et postiches : Lou Valérie Dubuis.
Marquillages : Marine Frileux.
Direction artistique : Pierre-Alain Clerc et Mickaël Bouffard.
Entracte musicaux assurés par les étudiants du cycle concertiste du Département de Musique Ancienne du CRR de Paris et du PSPBB.
Recherche scientifique et partitions : Matthieu Franchin et Gérard Geay.
Deux autres représentations seront données les 3 et 4 mai à Montpellier.
D’AUTRES ARTICLES