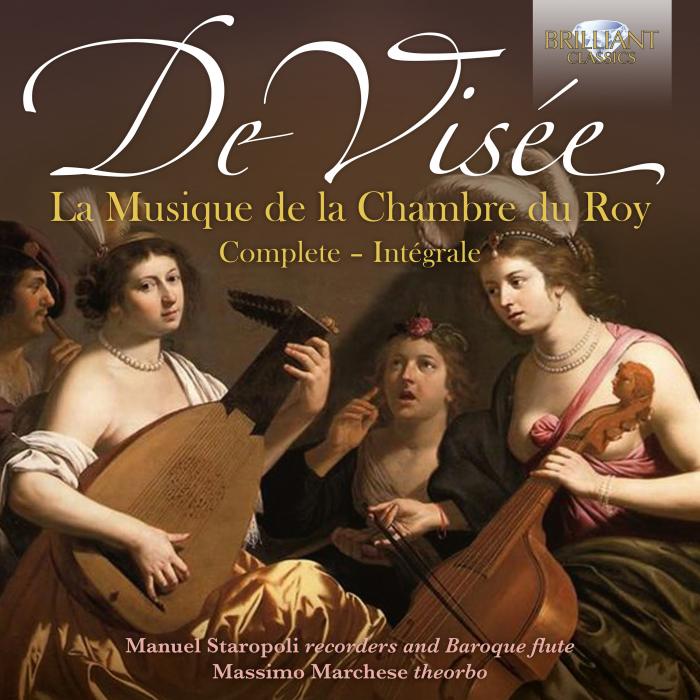par Wissâm Feuillet · publié mercredi 12 octobre 2016
Le festival d’Ambronay, qui fête cette année son trente-septième anniversaire, et qui compte maintenant parmi les scènes les plus réputées pour la musique ancienne, a de nouveau enchanté à tous points de vue le rédacteur du Babillard qui s’y est rendu cette pour le week-end. Du 23 au 25 septembre.
L’on pourrait dire que ce fut globalement, de vendredi à dimanche, un sans faute : toutes les prestations auxquelles nous avons pu assister nous ont semblé réussies, sous la direction de chefs talentueux, servies par des musiciens de qualité, maîtrisant à la fois leurs répertoires respectifs et — est-ce utile de le préciser ? — leurs instruments. Mais plus que cela, il semble que ce week-end à Ambronay a été placé sous le patronage d’un maître-mot : l’énergie. À croire que les artistes s’étaient concertés d’avance pour proposer des concerts explosifs, où la qualité de leurs interprétations n’avait d’égale que l’intensité de leur présence sur scène.
Nous consacrerons une rubrique de notre article à chacun des concerts que nous avons pu voir et entendre : que le lecteur se sente donc libre d’aller lire directement la critique qui l’intéresse.
Le week-end a été magistralement inauguré par un habitué de l’abbaye, Leonardo García Alarcón, qui avait réuni autour de lui trois ensembles : le sien propre (Cappella Mediterranea), l’ensemble Clematis et le chœur de chambre de Namur. Il est inutile de présenter Leonardo García Alarcón : les habitués d’Ambronay et les amateurs de musique baroque reconnaissent en lui un chef dynamique et spontané, doué d’une intelligence musicale supérieure, mais aussi un découvreur de musique oubliée qu’il s’emploie à faire redécouvrir avec une fougue difficilement imitable (pensons au désormais fameux Falvetti). Ce concert d’ouverture, sous le titre de Carmina latina, était consacré à de la musique Renaissance et baroque d’Espagne et d’Amérique du Sud, assez peu jouée et rarement illustrée au disque. Dans ce répertoire, Leonardo García Alarcón et Mariana Flores font, sans conteste, autorité. Peut-être sentent-ils mieux que d’autres cette musique qui, depuis un certain temps, les habite et qu’ils habitent superbement…
Le concert s’est ouvert avec force sur un chant processionnel en langue quechua, dont le caractère est à rapprocher de la marche ou de la pavane. Défilant sur ce chant solennel au son du tambour, les chanteurs, dissimulés au fond de l’abbatiale, ont formé un cortège qui s’est lentement déplacé jusque sur la scène où les ont rejoints les instrumentistes. Le ton donné par cette marche a été immédiatement altéré par le pétillant « Romerico florido » de Mariana Flores — un véritable « tube », à présent —, sanguin et coloré. Dans une robe rouge pailletée, la chanteuse a proposé une double performance remarquable, d’un bout à l’autre du concert : vocale, mais aussi physique. Ondulante, rendant l’énergie de cette musique rendue plus palpable encore par les mouvements de son corps, elle nous a fait sentir que ce répertoire vit, et qu’il a tout à voir avec la danse. Et cette énergie est communicative : Mariana Flores parvient à embarquer dans ses mouvements, dans sa danse, certains solistes qui, au fur et à mesure, ont su bénéficier de sa belle spontanéité. Nous retrouvons évidemment ces belles qualités dans « La Bomba » de Mateo Flecha, pièce qui s’apparente aux miscellanées de la Renaissance française, délicieusement croustillante. S’agissant du répertoire Renaissance, c’est-à-dire antérieur à la notion même de basse continue, le clavecin de Leonardo García Alarcón nous y a semblé déplacé mais, fort heureusement, discret.
Nous ne nous attarderons pas sur chacune des pièces du programme, mais il nous faut dire quelques mots du volet sacré de ce concert. En effet, si la musique profane était particulièrement représentée, la musique sacrée n’a pas été en reste : un « Salve Regina » de Juan de Araujo et un « Magnificat » de Francisco Correa de Araujo nous ont particulièrement époustouflés. Une parfaite fusion des voix et des instruments a permis aux musiciens d’atteindre un degré d’intensité remarquable, à couper le souffle. Nous ne croyons pas nous tromper en disant que pendant le « Salve Regina », le temps a été comme suspendu dans l’abbatiale.
Si la prestation d’ensemble est d’une tenue irréprochable, il n’en demeure pas moins que certains talents se font immédiatement remarquer. Nous pensons à Quito Gato, remarquable à la guitare plus qu’à l’archiluth, qui joue aussi le rôle de percussionniste, et fort bien, avec cela ! Parmi les continuistes, il faut aussi nommer Marie Bournisien, qui réalise la basse à la harpe avec une grande inventivité. Le contre-ténor (Leandro Marziotte ?) nous a paru, en revanche, un peu plus faible que ses collègues solistes en termes de puissance vocale, mais nous savons que la voix de contre-ténor a tendance, plus que d’autres, à être détimbrée. Inversement, le ténor Emiliano Gonzalez-Toro force peut-être un peu parfois sur le « bel canto » opératique.
Cette prestation débordante d’énergie nous a valu trois « bis », dont la très belle chanson d’Alfonsina, interprétée par Mariana Flores, qui a donné la preuve par la voix d’un lien évident entre la musique hispanique d’ « avant » et celle d’« aujourd’hui ».
S’il fallait retenir de ce week-end musical un « coup de cœur », une vraie découverte, il s’agirait probablement de l’ensemble Sollazzo, jeune ensemble de chanteurs et d’instrumentistes passionnés par la musique médiévale à laquelle ils se consacrent depuis plusieurs années. Que de jeunes gens se penchent sur les manuscrits du xve siècle, armés de vielles à archet et d’une harpe médiévale, est une très heureuse nouvelle : c’est que le Moyen Âge n’est ni poussiéreux, ni ennuyeux, ni sinistre. Au contraire, s’agissant de musique médiévale, tout reste à faire, tout est à inventer, puisque la pratique (intelligemment) informée de ce répertoire est assez récente et que, parmi ce qui a été fait jusqu’à maintenant, l’on pourrait dire familièrement qu’« il y a à boire et à manger ».
Ces cinq musiciens, presque tous issus d’une formation baroque, se sont rencontrés à la Schola Cantorum Basiliensis, où ils ont été formés dans l’un des meilleurs départements de musique médiévale d’Europe. Depuis, ils mènent de front plusieurs carrières, régies par des centres d’intérêt éclectiques qui, pour reprendre le mot de la soprane Perrine Devillers, les empêchent de « s’encroûter » : la musique baroque, la musique médiévale, et pour certains, la musique plus récente. Le concert qu’ils ont donné à Ambronay dans la salle Monteverdi confine à la révélation : l’interprétation qu’ils font de ces ballades et rondeaux amoureux issus du « Manuscrit de Chypre » et de la production de Mateo da Perugia, est à la fois fine, enjouée, et d’une expressivité inattendue. Qui a un peu fréquenté ce répertoire le sait pertinemment : la « partition » est sommaire, parfois difficilement lisible, et ne peut, si on la joue telle quelle, qu’ennuyer. (Nous renvoyons les lecteurs, à ce propos, aux recherches de Paulin Bündgen, qui a fait l’objet d’une de nos critiques récentes.) Le travail d’interprétation est donc primordial ; bien plus nécessaire, oserions-nous dire, que pour le répertoire postérieur, qui est bien plus « écrit ».
Les voix sont claires et pures, dépourvues d’effets ; « blanches », en quelque sorte. En somme, elles fuient la surenchère et n’en sont que plus belles, rendant justice à la transparence des lignes et honorant le texte — bien que la prononciation de l’ancien français reste à améliorer, malgré la gageure que représente une telle restitution. La harpe, qui les soutient, égrène accords ou contreparties avec délicatesse, soutenue par les deux vielles qui posent un tapis sonore léger, parfois très ornementé. Nous étions ravis de retrouver, parmi les musiciens, la charmante Perrine Devillers, dont la voix et le sourire nous avaient immédiatement séduits dans un récent disque consacré à Luzzaschi. La voix de Vivien Simon, si elle ne nous avait pas d’emblée convaincus, a pu faire ses preuves le lendemain, lors de la messe dont l’ensemble a assuré la partie musicale, à l’abbatiale. Ils étaient, sous les voûtes gothiques, bien plus à leur place que dans la salle Monteverdi, dont l’acoustique sèche ne leur rendait pas amplement justice. Malgré la longueur de la messe et une homélie vigoureuse, nous avons passé un très beau moment, peut-être encore plus riche que celui du concert de la veille.
En somme, c’est un ensemble à surveiller, qui nous réserve de belles surprises. Nous leur souhaitons de pouvoir poursuivre avec succès le programme « eeemerging » dans lequel ils sont bien installés, et nous attendons avec impatience la parution de leur premier disque (déjà enregistré !) en 2017.
C’est bien connu, le livret du « semi-opera » de Purcell The Fairy Queen est absolument incohérent : les actes sont sans rapport les uns avec les autres, les arguments sont minimaux, et aucune trame n’assure l’unité de l’ensemble. C’est un véritable « patchwork ». Pourtant, il s’agit d’une des merveilles musicales du Grand Siècle. Sébastien d’Hérin et son ensemble, Les Nouveaux Caractères, nous en ont donné la preuve samedi soir. Il y avait bien longtemps qu’aucun ensemble n’avait donné une version intégrale de The Fairy Queen. Alors que nous sommes habitués à entendre certains airs détachés et les suites d’orchestre jouées ou enregistrées pour elles-mêmes, Les Nouveaux Caractères ont donné l’œuvre dans son entier, airs, chœurs et pièces orchestrales. Pendant près de trois heures, l’énergie débordante des instrumentistes et des chanteurs nous a saisis. Non seulement la qualité musicale de la prestation a été impressionnante, mais la performance physique de tous est à saluer.
L’ouverture à la française a été jouée « à la française », c’est-à-dire sans réalisation de la basse-continue au clavecin. Malgré un tempo beaucoup trop rapide, elle nous a immédiatement plongés dans l’œuvre. D’un bout à l’autre, les percussions de Henri-Charles Caget ont soutenu l’attention de l’assistance par la variété de leurs textures. Les trompettes, quant à elles, justes dès leurs premières notes, et ce jusqu’à la fin, étaient d’une précision extrême : qu’on se le dise, c’est chose rare ! Quant aux anches, fièrement tenues par Elsa et Jérémie Papasergio (qui travaillent sur les anches « historiques ») ainsi que Béatrice Delpierre, elles se sont merveilleusement détachées de la masse de l’orchestre, avec subtilité mais franchise.
Nous avons particulièrement apprécié le deuxième acte, un acte allégorique, où se succèdent la Nuit, le Mystère, le Secret et le Sommeil personnifiés : l’alternance des ambiances y a été un véritable plaisir d’écoute. L’air du Sommeil, en particulier, était saisissant, de douceur et d’intensité mêlées. Il en va de même pour l’air « O let me weep » de l’acte V, où la très belle voix de Caroline Mutel et la trompette ont fait preuve d’une complicité sensible. D’autres voix se sont faites remarquer en bien : celle de Hjördis Thébault, qui a assuré deux solos à vocalises avec panache et sans bavure, et celle d’Anders J. Dahlin, haute-contre que nous connaissions déjà, qui, contrairement à ses camarades Samuel Boden et Julien Picard, a fait preuve d’une droiture et d’une puissance qui ont été remarquées, à tel point qu’un insecte assez corpulent est venu se frapper avec force sur son front pendant qu’il assurait un solo qu’il n’a pas interrompu pour autant !
Nous regrettons seulement que la direction de Sébastien d’Hérin soit encore un peu trop expressive, au point d’être, parfois, dérangeante pour les spectateurs, tant elle est bruyante et agitée. Entre la basse continue à assurer au clavecin et la direction, nous ne dirions pas qu’il faut choisir, mais il faut faire la part des choses : les quelques accords posés parfois par le chef, pendant quelques secondes, ou le doublage de la ligne de basse qu’il assurait de temps en temps à la main gauche n’ont pas été suffisants à notre goût. Faire (vraiment) ou ne pas faire, telle est la question. D’autres menues surprises se sont imposées à nous : la présence d’un serpent, tenu par Jérémie Papasergio, par exemple, dont nous nous sommes demandés quelle était la légitimité dans un opéra anglais… Mais qu’importe, puisque le résultat global était époustouflant. Nous attendons avec impatience la parution du disque que l’ensemble est, d’après nos sources, en train d’enregistrer ! Cette affaire est à suivre de près.
Si nous annoncions un sans faute, il est un concert qui, cependant, reste un peu en retrait pour n’avoir pas suscité notre émerveillement : celui de William Christie, entouré par des solistes des Arts florissants, qui ont donné à entendre des cantates et de la musique instrumentale de Bach. Mondialement connus, Christie et son orchestre, pense-t-on, n’ont plus à faire leurs preuves. Quoi qu’ils fassent, tout est bon à prendre. Des milliers de « fans » sont, de toute façon, acquis à leur cause. Raison de plus pour être exigeant. Intransigeant, même.
Ce concert, nous l’attendions avec impatience. Non que nous soyons des inconditionnels de William Christie, mais plutôt que son choix nous avait intrigué : Bach. Pourquoi Bach ? Pourquoi le répertoire allemand, alors que Les Arts florissants avaient fait de la musique française – et, dans une moindre mesure, de la musique italienne – leur « spécialité » ? Christie dans Bach, c’était, semble-t-il, une première. Après écoute, cela nous semble clair et sans appel : nous n’en voudrons pas à William Christie de ne pas réitérer l’expérience Bach.
L’interprétation qui a été donnée de ces cantates BWV 55, 202, et 211 dimanche soir, si elle est tout à fait acceptable, professionnelle, maîtrisée, est absolument sans envergure. Voilà du beau Bach, soigné, plutôt propret, mais cruellement conventionnel. Bref, William Christie n’a pas grand chose à ajouter dans ce répertoire qui a déjà connu bien mieux. Dès le départ, on note que les musiciens ont du mal à s’accorder sur un tempo : on sent des difficultés de calage entre les violons et le hautbois. Dans l’aria « Phoebus eil mit schnellen Pferden », le choix d’avoir confié le continuo au violoncelle doublé de la contrebasse est rédhibitoire : dans un continuo si virtuose, la contrebasse est pâteuse et laisse une impression de brouillon. Dans le troisième mouvement de la sonate en trio BWV 1039, les aigus des violons grincent et manquent de justesse. Enfin, la réalisation du continuo au clavecin et au positif, par William Christie lui-même, est fade et presque sans inventivité. Nous l’avons connu en meilleure forme.
Fort heureusement, William Christie sait s’entourer de jeunes – et de moins jeunes – musiciens talentueux, dont les qualités sont indéniables : la soprane Rachel Redmond nous a ravis par la rondeur et la puissance de son timbre chaleureux, de même que Reinoud Van Mechelen qui s’est, depuis quelques temps, joliment imposé parmi les plus belles voix de haute-contre. Enfin, Serge Saitta a assuré une partie de traverso irréprochable, aussi bien dans les cantates que dans la suite BWV 1067, où la fameuse « Badinerie » a ravi le public. Que d’ornements ingénieux, prévus ou improvisés, à la fluidité sans pareille ! Au-delà de ces quelques réussites, nous sommes restés sur notre faim. Et nous songerons davantage aux si beaux moments offerts par Leonardo García Alarcón, l’ensemble Sollazzo et Les Nouveaux Caractères.
D’AUTRES ARTICLES