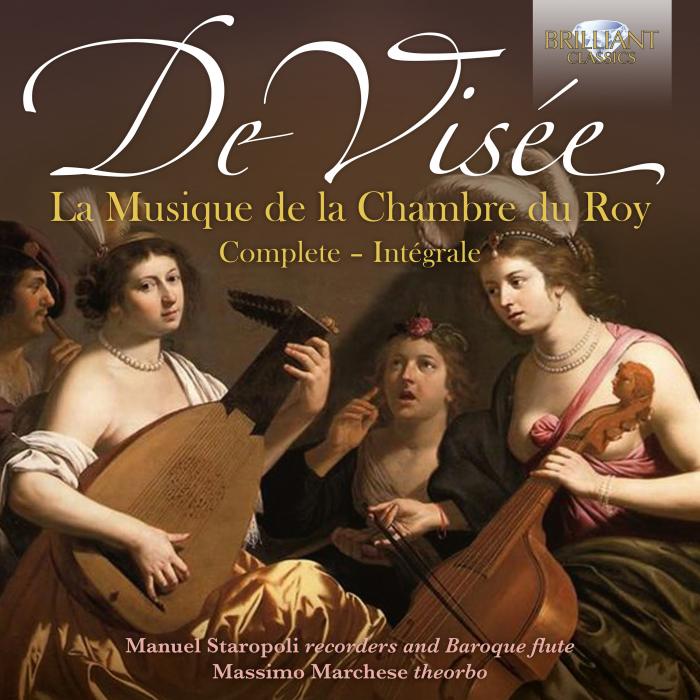par Loïc Chahine · publié lundi 19 decembre 2016 · ¶¶¶¶
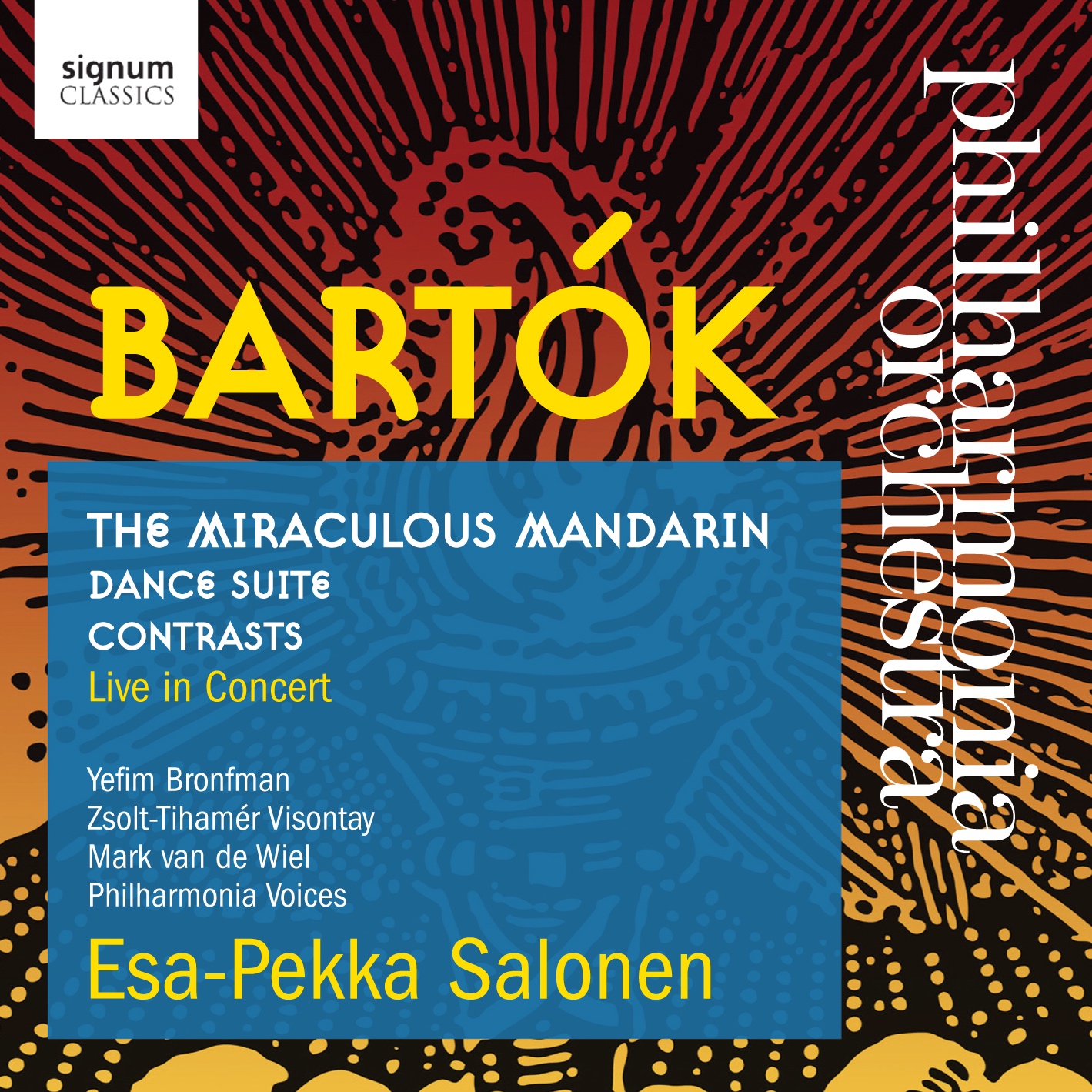
Le Mandarin merveilleux de Bartók fait partie de ces œuvres qui, comme le Sacre du printemps de Stravinski, rappellent ce que la modernité en musique doit au monde du ballet. Si Bartók tira de son ballet pantomime, commencé en 1918 et achevé en 1924 (puis revu en 1926 et 1931), suite d’orchestre qui est plus souvent jouée que la version intégrale et originale de l’œuvre1, c’est bien cette dernière qui est offerte à l’auditeur, accompagnée de la Suite de danses et d’une œuvre plus rare, Contrastes pour clarinette, violon et piano.
Le titre du Mandarin merveilleux fait peut-être penser à un univers de conte chinois plein de rêve et d’évasion. L’œuvre en est fort éloignée : l’introduction tonitruante décrit le bruit, le fracas, l’agitation d’une « grande ville moderne » — Bartók en avait horreur. L’action se passe dans un appartement occupé par trois vagabonds-voleurs et une femme, Mimi. En manque d’argent, les trois larrons vont avoir l’idée de plus ou moins prostituer Mimi : elle devra aguicher des hommes à la fenêtre, et les voleurs se chargeront de les détrousser. Le premier à mordre à l’hameçon est un petit vieux ; Mimi joue le jeu, elle l’aguiche en dansant, mais il n’a pas d’argent, il est donc jeté dehors. Le second, c’est un jeune homme, un « petit étudiant, le visage rose, les cheveux blonds, la cravate avec un large nœud2 » ; celui-là, il lui plaît bien, à Mimi, « il est adorable, ce pauvre petit », ils dansent ensemble ; mais il n’a pas plus d’argent que l’autre, et il est jeté pareillement. Surgit enfin un personnage plus important : « Un Chinois, un large visage jaune, des yeux bridés, inexpressifs, qui ne clignent pas, un regard fixe et perçant comme celui d’un poisson ; […] dans son dos, une longue natte noire » — bref, une sorte de Chinois de fantaisie, qui n’a pas grand-chose à faire au milieu du cadre réaliste (voire prosaïque) jusque-là installé. L’apparition du Mandarin chinois fait, en quelque sorte, basculer l’œuvre du côté de la fable, de l’apologue.
Mimi va, toujours sur ordre des trois brigands, chercher à séduire le Mandarin — aucune réaction. Pendant un certain temps. Et soudain, « son excitation va croissant » il est pris de furie, « traversé par une vague de sang en ébullition », « il regarde la fille – elle a peur de lui […], elle recule », « il veut l’empoigner » et se met à la poursuivre sauvagement. Les trois comparses se mettent alors de la partie — c’est-à-dire de la poursuite. Ils décident : il faut le tuer. Ils finissent par le mettre sur le lit — c’est tout un symbole — et par l’étouffer avec des oreillers. C’est bon, il est mort. — Et non, il revient à la vie. Re-poursuite. Un des bandits lui transperce le corps avec une épée ; il ne saigne pas ; il ne meurt pas. Diantre ! Ils finissent par le pendre au lustre ; « là-haut, une lueur pâle et singulière ; le ventre rond du Mandarin se met alors à irradier, tel celui d’un dieu Bouddha, tel un astre fantastique dans les airs. » Mimi finit par comprendre qu’une seule solution reste pour finir l’affaire : se livrer. « Elle l’enlace, l’étreint longuement. » (Bon, c’est un ballet, pas un porno, vous vous attendiez à quoi ?) « Le Mandarin fait entendre un râle d’extase. » (Sans commentaire.) « Alors, la blessure de son ventre […] se met doucement à saigner. Il perd peu à peu connaissance. […] son visage, déformé, sourit. Son désir s’éteint. […] Le Mandarin rend l’âme. »
Si Le Mandarin merveilleux est devenu une œuvre symphonique — car on ne le représente plus guère —, il n’empêche qu’il possède une trame narrative et même si on peut l’oublier — encore que l’on comprenne bien, à la seule écoute, qu’il y a une poursuite au milieu, et la description d’une espèce de désordre au début —, et au-delà de cette narration exacte, un esprit, un substrat sémantique : on doit comprendre à l’écoute, sentir que cela parle de violence et de désir.
À la tête du Philharmonia Orchestra, Esa-Pekka Salonen a su restituer ces éléments primaux. Ce qui frappe d’abord, c’est la virtuosité de l’orchestre : c’est ce qu’exaltent les premières mesures. Le chef réserve la plus grande violence pour plus tard, sans jamais se déparer d’une certaine distance, une certaine froideur même, jusqu’à ce que survienne la poursuite. Cette distance, cette froideur distillent un climat d’inquiétude que la violence du début et des éjections des deux premiers prétendants ne fait que renforcer. Le désir, bien sûr, on la cherchera du côté du thème de Mimi, exposé à la clarinette, celui par lequel elle aguiche, d’abord hésitant, puis plus affirmé ; il trouve ici sa dualité : certes, il semble appeler, attirer, mais il garde un je-ne-sais-quoi de hautain qui semble annoncer le danger sous-jacent. La douceur n’est pas absente : on la trouvera dans l’esquisse de valse qu’elle partage avec le « petit étudiant », d’une rare tendresse ici.
Les grandes forces de cette lecture demeurent la magnificence de l’orchestre, jamais pris en défaut, et l’intensité dramaturgique insufflée par la direction toujours incisive et intelligente d’Esa-Pekka Salonen, qui ménage une longue montée en puissance et en intensité, jusqu’au sacré mystère du mandarin qui se met à briller, splendide de révélation toujours aussi angoissée. La tension ne se relâche vraiment qu’à la toute fin, mais ce n’est au prix d’aucun sacrifice par ailleurs. En somme, de cet équilibre entre la richesse et la beauté du son de l’orchestre d’une part, et d’autre l’acuité du drame, l’électricité de la direction, naît une version qui échappe à la fois à l’affadissement ou au trop grand hédonisme et à la sécheresse.
La Suite de danse sera encore à la gloire de l’orchestre, de la beauté de ses timbres, mais l’on ne retrouvera pas la même concentration ; l’œuvre, aussi, s’y prête considérablement moins, et faire passer ces quasi-bluettes — même si une « bluette » de Bartók, c’est toujours très au-dessus de ce que le mot de bluette suggère — après le chef-d’œuvre qu’est le Mandarin n’est pas à leur avantage. Notons toutefois le très beau finale où chef et orchestre renouent avec la profondeur du Mandarin.
Pour conclure le CD, Yefim Bronfman, Zsolt-Tihamér Visontay et Mark van de Wiel livrent une version engagée et plutôt réussie de Contrastes, une œuvre de Bartók plus rare, mais peut-être aussi moins inspirée qui, certes, ménage de beaux moments, mais peine à s’imposer, sans doute en grande partie à cause de son premier mouvement un peu difficile d’abord. Ici, l’on pourrait souhaiter un son de violon un peu plus rond, plus en phase avec le piano et la clarinette de ce point de vue. La clarinette de Mark van de Wiel, justement, allie rondeur et clarté, sans jamais se complaire dans la caricature de l’instrument. Le jeu de Yefim Bronfman, enfin, est tonique (quelle puissance dans le finale !) mais non sans nuance.
Si les deux œuvres « de complément » ne déméritent pas, c’est donc bien le Mandarin merveilleux d’Esa-Pekka Salonen et du Philharmonia Orchestra qui constituent la substantifique moelle de ce disque — et quelle moelle !
1. Esa-Pekka Salonen l’a d’ailleurs enregistrée, à côté du Sacre du Printemps, à la tête du Los Angeles Philharmonic, pour un disque paru en 2006 (Deutsche Gramophone). ↑
2. Les citations sont tirées de l’argument original du ballet, cité par Claire Delmarche, Béla Bartók, Fayard, 2012. ↑
INFORMATIONS
Philharmonia Orchestra
Esa-Pekka Salonen
Pour Contrastes :
Yefim Bronfman, piano
Zsolt-Tihamér Visontay, violon
Mark van de Wiel, clarinette
1 CD, 68’33, Signum Records, 2016.
D’AUTRES ARTICLES